À 9 ans, vous fuyez la Roumanie avec votre famille et vous emménagez à Nice. Là, vous êtes fasciné par les lumières des cinémas.
À cette époque, je n’avais encore jamais mis les pieds dans un cinéma. Ça m’angoissait de remonter du centre-ville vers l’obscurité des collines où nous habitions. Seuls les cinémas étaient bien éclairés. Pour moi, c’était un lieu qui chassait les peurs. Bien plus tard dans ma vie, j’ai repris cette idée avec les cinémas mk2 Quai de Seine et mk2 Quai de Loire. En éclairant les bâtiments, on éclaire aussi l’eau entre les deux. J’ai pu ainsi donner l’impression d’un espace complet avec des lumières rouges d’un côté, bleues de l’autre, et, au milieu, des reflets blancs dans l’eau. De fait, sans forcément que les gens s’en rendent compte, ils sont dans un drapeau tricolore.
En 1955, vous voyez des films au côté de François Truffaut et d’André Bazin à la Cinémathèque. Vous échangiez avec eux ?
André Bazin, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, c’étaient des trublions. J’ai commencé à aller beaucoup au cinéma quand j’ai préparé l’IDHEC nous montrait les films qu’il aimait, et il y avait cette équipe des Cahiers du cinéma qui commentait ses choix. Ils attaquaient très violemment l’académisme qu’on étudiait à l’IDHEC – Claude Autant-Lara, Julien Duvivier… – et défendaient d’autres cinéastes – Alfred Hitchcock, certains Américains comme Howard Hawks, ou encore le cinéma italien. On était très fiers d’être dans la même salle qu’eux, même sans jamais leur parler.
Puis vous devenez assistant sur des tournages. Après Le Dialogue des Carmélites (1960) de Philippe Agostini et Raymond Léopold Bruckberger, vous avez une aventure de deux ans avec une des actrices du film, Jeanne Moreau.
C’est aussi clair que ça dans le livre ?
On le comprend… Vous êtes restés amis après ça ?
Non, je l’ai perdue de vue pendant des années. On ne s’est revus que tard, un peu par hasard…
Vous dîtes avoir « désappris » les enseignements de l’IDHEC sur le tournage du court métrage La Paresse de Jean-Luc Godard, en 1961. Mais, juste avant cela, vous étiez assistant sur Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda, qui n’avait pas non plus des méthodes conventionnelles…
À cette époque, une espèce de baroudeur, Georges de Beauregard, produisait plein de jeunes réalisateurs, dans des conditions invraisemblables… On était effectivement hors système.

Vous confiez aussi que vos expériences avec Marguerite Duras, qui a scénarisé votre court métrage Nuit noire, Calcutta (1964), et Samuel Beckett, dont vous avez adapté la pièce Comédie deux ans plus tard, vous ont rendu alcoolique pendant un temps.
Pour partager de vrais moments, d’abord avec Marguerite, puis avec Sam, j’ai dû m’attabler avec eux. Mais ce n’est pas eux qui m’ont entraîné à boire, mais mon envie de les côtoyer. Je calmais mon angoisse avec l’alcool. C’est ce qu’ils devaient faire, eux aussi… J’étais un gamin face à ces monuments. C’était assez formidable d’essayer d’être, au moins par l’alcool, à leur niveau !
En 1974, après avoir réalisé votre troisième et ultime long métrage, Coup pour coup (1972), vous ouvrez votre première salle de cinéma, le 14-Juillet Bastille, à côté d’un cinéma porno et d’un autre programmant des films de karaté.
J’étais bien entouré, mais ce n’était pas les genres de films qui m’intéressaient. Je voulais faire de ma salle un lieu de résistance au giscardisme, de contre-culture et de confrontation d’idées, l’inscrire dans la continuité de Mai 68. Le cinéma porno est devenu un cinéma d’art et d’essai, le Majestic Bastille. L’autre salle a plus tard été remplacée par l’Opéra Bastille.
Vous êtes passé d’assistant opérateur de Jean-Luc Godard à producteur de son film Sauve qui peut (la vie) (1980). Votre relation a connu beaucoup d’évolutions…
C’était comme une relation amoureuse. Notre rupture, quand je lui ai dit que je n’allais pas produire Passion (1982), s’est passée dans les pleurs. J’ai toujours eu une grande admiration pour le Godard cinéaste. Comme James Joyce ou Marcel Proust en littérature, il a changé le langage du cinéma.
Vous évoquez aussi régulièrement la figure du critique de cinéma Serge Daney, que vous sembliez beaucoup admirer.
On était voisins pendant un temps, on déjeunait souvent ensemble. Il avait le regard que j’attends des critiques. Dans mes réflexions sur le cinéma, j’ai besoin de discussions contradictoires, qu’on me dise autre chose que ce que je pense. Serge, même quand il n’aimait pas un film, il se prenait la tête, il démontait sa mécanique et proposait autre chose. Je trouve que c’est une façon très positive de penser le monde. Démolir, ça ne sert à rien, à mes yeux.
Certaines représentations de la violence, par exemple chez Quentin Tarantino, vous dérangent. Avez-vous déjà refusé de projeter un film ?
À partir d’une certaine expérience de l’histoire, en l’occurrence les Allemands et la Shoah, il y a des choses que je ne peux pas accepter, comme l’idée de la violence faite aux corps, du mépris de leur intégrité. Je n’ai pas voulu passer La Passion du Christ de Mel Gibson, parce que je considère que c’est un film fasciste. Après, il y a des films détestables, mais que les gens ont très envie de voir. C’est embêtant de ne pas leur montrer. Que faire dans ces cas-là ? Et puis, qu’est-ce qu’un film détestable ? C’est compliqué, et je ne suis pas le maître du monde. Mais la question de la contrainte éthique doit se poser en permanence.
En 2001, vous maintenez Baise-moi de Virginie Despentes en salles, alors que l’association Promouvoir tente de le faire classer X. Vous reconnaissez avoir pris cette décision avant même d’avoir vu le film…
Je ne l’ai toujours pas vu, d’ailleurs ! Cette association d’extrême droite, toujours en activité, a obtenu l’interdiction du film par le Conseil d’État. J’aurais pu me soumettre à la loi, mais là, j’ai choisi la liberté d’expression. C’est le genre de décision instinctive, pas toujours juste, difficile à expliquer. J’ai toujours voulu résister à certains types d’excès de pouvoir ou de loi. Je trouvais la décision du Conseil d’État injuste. Encore aujourd’hui, je suis très content de mon choix.
Avant la proposition de Caroline Broué, aviez-vous l’envie d’un ouvrage sur vous, comme un bilan ?
Pas du tout, dans la mesure où j’aime bien le silence. C’est le désir très fort de Caroline qui m’a donné envie. Sinon, ça m’aurait été assez indifférent de ne pas raconter.

REMONTER LE FIL
Début 2015, écoutant Marin Karmitz lors d’une table ronde qu’elle anime à la villa Gillet, à Lyon, Caroline Broué se rend compte qu’il ne s’est jamais exprimé sur l’affaire du Conseil de la création artistique. En 2009, l’homme de gauche avait suscité critiques et incompréhensions en acceptant la proposition de Nicolas Sarkozy, alors président de la République, de diriger cette commission chargée de réfléchir au développement et au rayonnement de la création artistique française. Six ans plus tard, Karmitz conseille à la journaliste de « remonter le fil de l’engagement ». Elle s’entretient donc longuement avec lui et rédige Comédies. Ici, pas de questions-réponses, mais un récit qui alterne leurs deux voix, sans distinction marquée. Celle de Caroline Broué offre souvent un contrepoint au récit passionné de Karmitz, qui mêle souvenirs et engagements politiques. « Je voulais faire sentir mes questionnements et mes critiques sur les contradictions de l’homme », explique-t-elle. À chaque lecteur de suivre le fil et de se forger son opinion. T. Z.

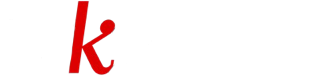 Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2
Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2 10min
10min Article
Article