Chaque semaine, Trois Couleurs donne la parole à une personnalité du cinéma ou de la culture. Ils et elles nous racontent leurs engagements à travers les moments-clé de leur parcours.
Vous êtes née à Orléans en 1980. Était-ce déjà dans un environnement féministe, engagé politiquement ?
Engagé politiquement, on ne peut pas dire ça. Féministe, on ne peut pas dire ça non plus parce que dans les années 1980, le mot « féminisme » était complètement banni du vocabulaire. Je crois que la génération de ma mère, ces femmes des années 1980, s’est fait avoir dans tous les sens.
D’un côté, elles étaient des femmes qu’on avait « autorisées » à s’émanciper, elles venaient juste d’avoir le droit d’avoir un compte en banque, de travailler [seulement depuis la loi du 13 juillet 1965 sur les régimes matrimoniaux, donnant le droit aux femmes d’exercer une activité professionnelle sans l’accord de leurs maris, et de gérer leurs biens propres, ndlr.] De l’autre, malgré leurs revendications d’indépendance et d’autonomie financière, on ne les avait absolument pas libérées de tout un tas de mécanismes de domination : la charge domestique, la charge parentale…
Elles étaient écrasées sous la nécessité d’être une bonne femme au foyer, tout en ayant aussi celle d’être une working girl, belle, mince, gagnant de l’argent. Le mouvement féministe était dans un gros creux de la vague [après la deuxième vague féministe couvrant la fin des années 1960 et les années 1970, ndlr.], et elles n’avaient aucune clé pour revendiquer leur autonomie. Donc, moi, j’ai grandi dans une famille où on encourageait les femmes à travailler, à gagner de l’argent, à être autonomes, mais je n’ai jamais vraiment entendu de discours politiques, de revendications féministes comme celles que je peux porter aujourd’hui.
Quand vous étiez ado, vos héroïnes, à la télé, au cinéma ou dans la musique, ont-elles eu un rôle dans votre prise de conscience féministe ?
Hé ben, toujours pas ! Parce que, dans les années 1990, quand j’étais ado, les femmes que j’admirais, c’étaient les top models. J’ai été élevée dans le culte de Claudia Schiffer, Cindy Crawford, les héroïnes des séries comme Beverly Hills 90210…
On nous posait en exemples des femmes puissantes, parce qu’elles gagnaient de l’argent et étaient très célèbres, mais qui en même temps se conformaient à tout un idéal de féminité validiste[le validisme est l’oppression normative vécue par les personnes vivant en situation de handicap, ndlr.], grossophobe, raciste.
Du coup, il manquait tout un pan de déconstruction dans mon éducation d’adolescente. J’ai vécu ces années à lire les magazines Jeune et jolie et OK Podium, dans lesquels on expliquait aux jeunes filles comment sucer son mec, plaire aux hommes, rester mince.
Vous vous souvenez des premières causes que vous avez défendues ?
Mes premières manifs, c’étaient les mobilisations altermondialistes. Ça devait être un rassemblement contre le Forum économique mondial de Davos, en 1999. Comme beaucoup de gens de ma génération, la question de l’écologie a été ma première prise de conscience politique.
Qu’est-ce qui a ensuite marqué votre envie de faire du journalisme ?
C’est le métier que j’ai toujours voulu faire. Je pense qu’à l’origine, ce désir était basé sur une qualité ou un défaut que j’ai – ça dépend comment on le présente – qui est ma curiosité, cette envie de comprendre ce qui se passe, d’observer, d’écrire. J’ai formulé très tôt l’envie de devenir journaliste au magazine Elle, dans la presse féminine, parce que j’avais ce goût à la fois pour les questions de société qui concernaient les femmes, mais aussi pour la mode, tout ce qui était lié à ce qu’on appelle aujourd’hui le « lifestyle ».
Avant d’intégrer la rédaction de Elle, vous avez étudié au CFJ, vous avez fait des stages dans plusieurs rédactions. Pendant ces moments de formation, commenciez-vous déjà à interroger, à déconstruire, certaines pratiques du journalisme ?
Bien sûr. Même si le CFJ est une école que j’aime beaucoup, où j’ai énormément appris, il y avait une vision du journalisme assez traditionnelle. Je pense que ça a changé depuis. J’ai fait ma formation au Monde et à l’agence Reuters. C’est là que j’ai commencé à identifier des mécanismes de genre : le fait qu’il y ait si peu de femmes rédactrices en chef, que certains sujets incombaient plus aux femmes que d’autres…
Ma première prise de conscience, c’est quand j’étais en stage à Paris-Normandie. On était huit ou neuf de ma promo à faire un stage cet été-là, c’était très sympa, on avait pris un appartement en coloc dans le centre de Rouen. Mais en fait, dès le premier jour de stage, il y a eu une répartition des garçons et des filles. On a mis les garçons à l’étage politique-société-international, et les filles en secrétariat de rédaction, à la relecture. C’était vraiment dingue ! Je me rappelle que je m’étais révoltée.
Il y a une autre chose qui m’avait choquée : le matin, quand on arrivait, les hommes qui travaillaient à Paris-Normandie venaient dans la salle où on était, et serraient la main à tous les garçons, tandis que les filles devaient leur faire la bise… Je me rappelle que je leur ai dit : « Moi, j’ai pas envie de vous faire la bise. On a qu’à se serrer la main comme vous faites avec mes collègues. » Je crois que c’est la première fois qu’on m’a traitée de féministe !
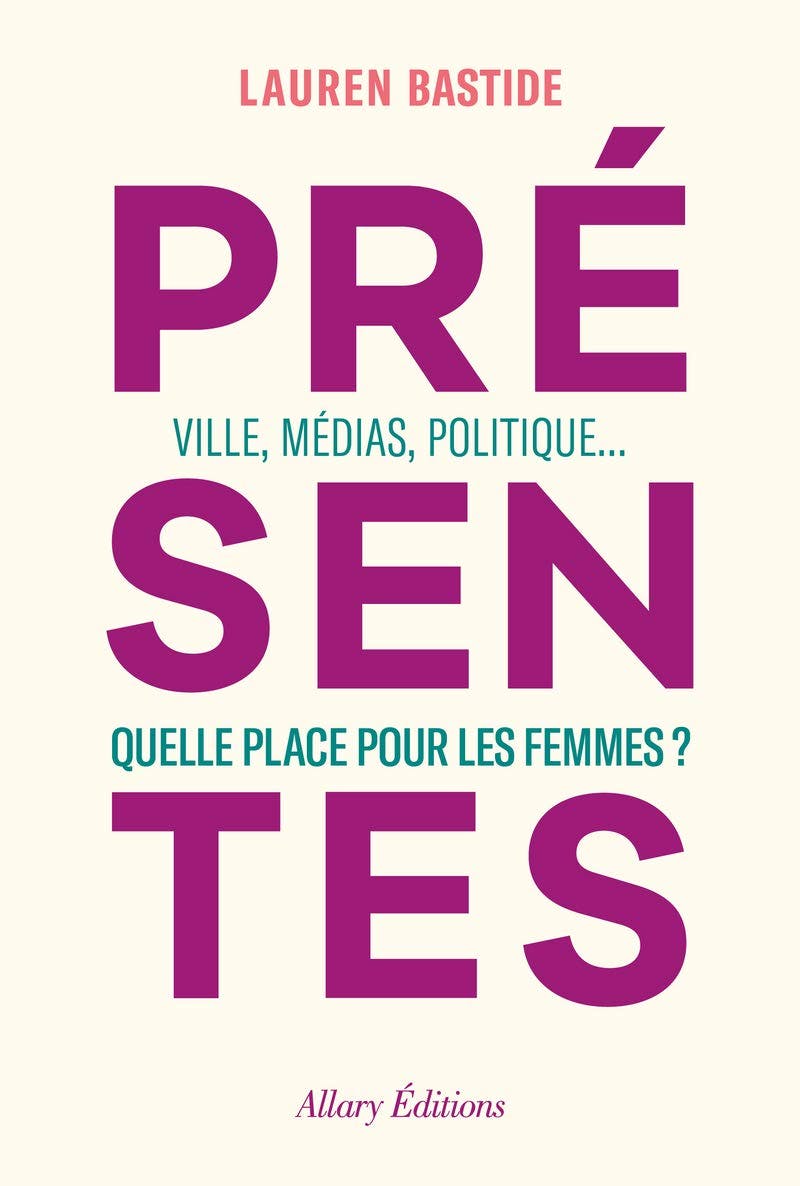
Dans votre livre Présentes – villes, médias, politique : où sont les femmes (Allary), vous expliquez que ce sont des lectrices qui, en critiquant certains articles de Elle, ont fait évoluer votre féminisme. Comment ça s’est passé ?
On ne se réveille pas un beau matin en sachant ce que c’est que de subir le racisme et la grossophobie, on l’intègre en entendant le récit des personnes qui les subissent. Il y a eu notamment un article, une espèce de marronnier de la presse féminine dont le titre change selon les années : « La mode pour les rondes ». Généralement, on y montre des filles qui font du 42. Cette année-là, j’avais eu la charge de faire cet article.
C’était l’époque des blogs – d’ailleurs ça a été fondamental, le développement sur internet de ces nouveaux espaces, où de nouvelles voix ont pu émerger. Donc des blogueuses m’ont interpellée en me disant : « 42, c’est la taille moyenne des Françaises. Tu es au courant qu’il y a des femmes qui font une taille 50, 52, 54 ? À quel moment, dans votre journal, vous parlez de nos problématiques, de notre incapacité à trouver des vêtements à notre taille dans les grandes enseignes, des discriminations qu’on peut subir dans l’espace public ? »
C’est la première fois que j’ai réalisé que j’avais des angles morts, des pans entiers de la société que je ne voyais pas, que tout regard journalistique est un regard situé. C’est à partir de là que j’ai commencé à tirer le fil, à comprendre qu’on ne pouvait pas se contenter de lutter contre le sexisme. Qu’il s’imbriquait avec tout un tas d’autres discriminations systémiques que sont le racisme, le validisme, la lesbophobie, la transphobie et la grossophobie.
Le premier biais que j’ai pu identifier, c’est plutôt par rapport à la blanchité. A Elle, je me suis rendu compte que toutes les questions qui concernaient les femmes non-blanches était complètement invisibilisées dans les pages du magazine. Pour la simple et bonne raison que la rédaction était constituée à presque 100% de personnes blanches. C’est là que j’ai pris conscience qu’on ne pouvait pas porter un regard universel sur ce qu’étaient les femmes, si on décrivait toujours une femme qui était toujours blanche, hétérosexuelle, bourgeoise, mince.
Quand, en 2016, vous créez Nouvelles Écoutes et le podcast La Poudre, il s’agissait pour vous de faire entendre ces voix invisibilisées ?
La Poudre, c’était un geste de compensation. C’était vraiment la volonté de venir porter dans l’espace médiatique les voix qu’on entend moins, à commencer par les voix des femmes. Je cite souvent ce chiffre : le temps de parole des femmes dans les médias, c’est 24%, un chiffre qui ne bouge pas, plus ou moins stable depuis plusieurs années.
Je me suis dit que j’allais créer un média où on entendrait que des femmes, pour compenser. Et puis, pour lutter contre ce biais qui est de toujours représenter les mêmes femmes, j’ai eu aussi à cœur de montrer une diversité de femmes dans le podcast, et surtout de faire entendre leurs récits.
Quels entretiens de La Poudre vous ont le plus marquée ?
C’est une question super difficile ! Il y en a tellement. Rencontrer des femmes pour qui j’ai une admiration infinie, comme Gloria Steinem ou Vandana Shiva, ou Maggie Nelson, ça marque une carrière, ça marque une vie.
Après, sur le plan de la rencontre humaine, je n’oublierai jamais le moment que j’ai vécu avec Latifa Ibn Ziaten, dont la force de résilience m’impressionne, la façon aussi dont elle transformé le drame qu’elle a vécu, l’assassinat de son fils par un terroriste, en message de paix et d’amour[elle est la mère d’Imad Ibn Ziaten, militaire assassiné à Toulouse par le terroriste Mohammed Merah en 2012. Depuis ce drame, elle a fondé et milite au sein de l’association IMAD pour la Jeunesse et la paix, ndlr.]. C’est une grâce de pouvoir s’entretenir pendant une heure avec une femme aussi forte.
Je suis fière aussi d’avoir interviewé Salcuta Filan, l’héroïne du très beau documentaire 8, avenue Lénine de Valérie Mitteaux et Anna Pitoun, une femme Rom qui a vécu un parcours migratoire, dans lequel elle a subi des discriminations racistes, et de classe, très fortes. Il n’y a pas beaucoup d’espaces médiatiques dans lesquels elle a une heure pour raconter sa vie dans le détail.
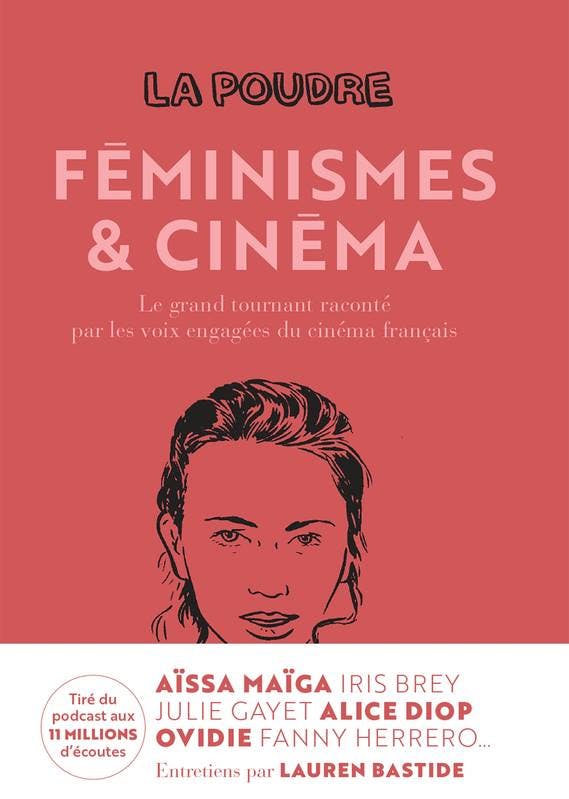
Vous sortez un livre, La Poudre – Féminismes et Cinéma, réunissant vos entretiens avec des cinéastes comme Amandine Gay, Rebecca Zlotowski, Houda Benyamina…. Récemment, quels films vous ont plu ?
J’ai été très marquée par Mignonnes de Maïmouna Doucouré. Je trouve qu’elle a un talent dingue, une façon de filmer unique, à hauteur d’enfant. Elle retranscrit les émotions avec énormément de force et de pudeur, tout en n’étant jamais dans le voyeurisme.
Dans Mignonnes, ce que je trouve intéressant, c’est qu’il y a une mise en perspective : il y a à la fois la dénonciation de l’hypersexualisation des adolescentes dans la société, et celle de ce qui peut peser sur les épaules des femmes dans un contexte de traditions religieuses extrêmement rigides. Le féminisme doit savoir articuler ces lieux où les femmes peuvent être entravées, c’est en cela qu’il y a une grande justesse dans la vision de Maïmouna Doucouré.
Selon vous, dans les années à venir, quel rôle va jouer le cinéma dans l’évolution de la société et des représentations ?
Un rôle fondamental, comme il l’a toujours fait, comme il continue à le faire. Le cinéma, c’est le miroir du monde, un endroit où on décrit ce qui se passe dans la société mais qui permet aussi à la société de se voir, d’évoluer, de proposer des représentations qui vont lui permettre de changer. Plus on verra de femmes, de personnes non-blanches, de personnes LGBTQIA+, devant et derrière la caméra, et même aussi dans les jurys ou les sociétés de production, plus l’impact politique et sociétal sera fort.
Crédit image de couverture : © Marie Rouge
