Pourquoi la singularité de l’expérience féminine occupe-t-elle si peu nos écrans ? Dans son essai Le regard féminin, Une révolution à l’écran (à paraître le 6 février) Iris Brey, docteure en études cinématographiques et journaliste, spécialiste des questions de genre à l’écran, propose de théoriser sans l’essentialisme attendu le « female gaze », une manière de filmer le corps et le plaisir débarrassée du voyeurisme, dans une démarche égalitaire et joyeuse. En nous invitant à déplacer notre regard sur des chefs-d’œuvre reconnus, des films plus confidentiels et des séries contemporaines, l’autrice livre un manifeste esthétique et politique, qui questionne sans tabou l’hégémonie masculine omniprésente dans notre société et le monde intellectuel.
Comment en êtes-vous arrivée à théoriser le « female gaze », une notion jusqu’ici peu (voire pas) développée par la critique ?
Quand je faisais mes études de cinéma aux États-Unis il y a dix ans, j’ai découvert l’article de Laura Mulvey Visual Pleasure and Narrative Cinema . Pour la première fois, j’ai compris que l’on pouvait mobiliser les études de genre pour parler de cinéma, et plus spécifiquement de « female gaze ». Mais comme rien n’avait été théorisé à ce propos, je me suis tournée vers des philosophes, tels que Merleau-Ponty, Judith Butler, pour explorer la phénoménologie, qui renvoie à l’expérience d’un corps vécu, et sortir de ma formation académique, davantage basée sur des écrits psychanalytiques.
En quoi le « female gaze » tel que vous l’entendez n’est pas le strict équivalent du « male gaze », mais est au contraire libérateur et inclusif ?
L’idée de « male gaze » renvoie au fait de prendre du plaisir à regarder une femme comme objet, mais aussi au concept d’identification spectatoriale. Celui qui regarde s’identifie à la caméra, elle-même relais du regard du spectateur homme, dans une forme de triangulation. Or, le « female gaze », ce n’est pas juste transformer « l’objet-femme » en « objet-homme », prendre du plaisir en objectivant un corps masculin nu. C’est réfléchir à une nouvelle manière de propager du plaisir par une mise en scène qui rend le personnage, autant que le spectateur, sujet et actif. Par exemple, dans Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino érotise Brad Pitt en le montrant torse-nu sur un toit, mais ce n’est pas du « female gaze ». La question, ce n’est ni le genre du cinéaste, ni le genre de la personne filmée, mais la grammaire cinématographique mise en place pour faire circuler le regard désirant. Le « female gaze » n’est pas nécessairement généré par des films réalisés par des femmes. C’est cette idée qui permet de sortir de l’essentialisme.
D’où, aussi, la dimension politique que renferme le « female gaze ».
Oui, car c’est un geste conscient, que beaucoup de femmes n’ont pas envie d’associer à leur geste artistique. Je ne juge pas cette démarche : mais créer du « female gaze » est forcément le résultat d’une réflexion, puisque c’est aussi se défaire d’un inconscient patriarcal. Les hommes sont tout aussi capables de le faire -s’ils en ont envie. Ce qui mène à cette autre question : pourquoi si peu d’entre eux ont le réflexe de retranscrire l’expérience féminine ? Parce que c’est un travail de déconstruction qui peut faire peur : beaucoup redoutent d’y perdre du plaisir. Une fois ce regard adopté, les œuvres évoluent d’une façon nouvelle…Je revendique cette démarche comme un geste joyeux, qui permet de détourner notre vision vers des champs inexplorés. Nos cinéastes – notamment nos cinéastes hommes – se réfèrent depuis cinquante ans aux mêmes films de Truffaut, de Godard…Sortir de ces écoles-là, c’est s’extraire d’une tradition très liée à la famille dans le cinéma français, dans le sens de « grande famille du cinéma », qui fait toujours jouer les mêmes acteurs, les « fils de », mais aussi de chapelles théoriques qui vénèrent toujours les mêmes hommes. Même dans Little Women de Greta Gerwig,il y a ce besoin de faire plaisir aux « papas », à nos « pères » – mais aussi à nos « pairs ». La réalisatrice se situe encore dans un entre-deux : narrativement, elle propose une relecture féministe du roman, en choisissant une nouvelle fin. Mais formellement, le spectateur n’a jamais accès aux émotions des héroïnes, notamment parce que Greta Gerwig est encore tributaire de l’héritage patriarcal de la Nouvelle Vague, par exemple lorsqu’elle fait lire aux personnages leurs lettres face-caméra, une technique qui est aussi une pure citation de Truffaut.
Vous expliquez aussi que la critique française est souvent réticente à utiliser le vocabulaire des gender studies, car cela équivaudrait à porter sur les œuvres un regard moralisateur. Comment expliquer ce préjugé ?
Il y a une grosse incompréhension de la part de la critique française face à la démarche de ceux qui ont envie de réfléchir aux questions de genre. Parler de female ou de male gaze, ce n’est pas invoquer la morale, ni la sociologie, c’est parler d’esthétique. L’esthétique étant évidemment politique, c’est être aveugle que de ne pas vouloir interroger ce que la mise en scène diffuse comme discours et comme parole. Critiquer des œuvres qui ont été formatrices pour toute une génération, ce n’est pas les détruire ni exercer une censure, mais les faire dialoguer avec le temps présent. Je retourne la question à ces hommes : quelle censure exercent-ils, eux, tous les jours ? On le voit bien avec J’accuse de Roman Polanski. C’est un film qui a été largement financé, distribué, vu. Aller voir ou pas le film est de toute façon un choix individuel. Par contre, les questions d’argent et de production nous parlent d’un système, d’une société dans laquelle les hommes qui agressent les femmes, les violent, ne sont pas punis, et continuent à être protégés par leur statut d’artiste. Interroger cette protection, c’est interroger la perduration de la culture du viol, la minimisation des agressions faites aux femmes dans la vie réelle, et la postérité. Il existe un cimetière d’œuvres réalisées par des femmes, on en est tous responsables. Le questionnement s’applique aussi aux critiques de cinéma. En rédigeant la première version de mon livre, j’ai réalisé que je mobilisais beaucoup de références théoriques à des hommes, parce que je me sentais obligée de montrer que je les avais lues, que je m’inscrivais dans leur sillage. Je les ai finalement enlevées pour me défaire de cette autorité paternelle.
Y a-t-il des mises en scène qui vous ont marquées, et qui permettent de contourner le « male gaze » tout en retranscrivant l’expérience féminine ?
Dans Fleabag, l’adresse directe à la caméra pour casser un moment d’érotisation, comme pour être au plus près des corps, nous faire ressentir les textures de peau. Chez Alice Guy, on retrouve beaucoup l’utilisation du gros plan pour retranscrire l’expérience d’une femme qui a du désir pour des objets phalliques alors qu’elle est enceinte. Tout un ensemble d’astuces qui questionnent la manière dont on a appris à désirer. Hormis les films de Jane Campion et Andrea Arnold, où l’on voit les femmes avoir du plaisir dans le cadre de relations hétérosexuelles, il faut chercher du côté des récits lesbiens pour voir des orgasmes. Orgasme, ménopauses, grossesse, avortement, accouchement : tout ce qui est lié au corps féminin n’a pas été mis en valeur.
À propos de Wonder Woman, vous expliquez que la réalisatrice Patty Jenkins résiste à l’objectivation du corps de son héroïne grâce à des effets de mise en scène. On a pourtant le sentiment que l’intrigue de Wonder Woman est un peu réactionnaire, notamment dans son dénouement, lorsque la protagoniste sauve l’homme qu’elle aime avant de conclure que « seul l’amour peut sauver le monde ».
Toutes les contradictions sont bonnes : elles problématisent, complexifient le propos. Dans Wonder Woman de Patty Jenkins, la première scène d’amour sur le bateau m’a particulièrement frappée. L’héroïne y explique à son love interest qu’elle n’a pas besoin d’un homme pour jouir. La première demi-heure du film offre aussi une vision extrêmement puissante, où l’on ne voit que des femmes lutter ensemble, sans se soucier d’une présence masculine. Et puis tous les films ne sont pas obligés d’aller au bout d’une déconstruction d’un mythe ou d’une mythologie : pour moi la façon de filmer de Patty Jenkins suffit déjà à rendre le film subversif. Avec Une Fille facile par exemple, Rebecca Zlotowki complexifie ces enjeux. On y trouve une vraie réflexion sur la façon de filmer le corps de Zahia, notamment lorsque son sexe est filmé en très gros plan -une image identifiée comme un rêve qui permet d’établir une distanciation pour bloquer l’érotisation. Mais ce n’est pas non plus du female gaze : jusqu’au bout, les héroïnes nous échappent. Chez Rebecca Zlotowski, il y a une dialectique entre le geste artistique inconscient et le geste artistique conscient. Comme si elle s’autorisait à laisser une part de son inconscient prendre possession de sa caméra, tout en étant dans une très grande cérébralité, une réflexivité sur son travail.
On a beaucoup parlé de Game of Thrones comme d’une série féministe, représentant des femmes avec du pouvoir. Or vous expliquez que la série est assez conservatrice : elle prendrait notamment un plaisir voyeuriste à filmer le viol de ses héroïnes comme un spectacle.
Ce n’est pas parce qu’une série met en scène des personnages féminins puissants qu’elle est féministe. Dans Game of Thrones, il y a clairement un manque de réflexion sur la manière de filmer les scènes de sexe – qui pour nous donner du plaisir s’appuient sur des femmes-objets. Beaucoup de messages de la série nous parviennent un peu brouillés car les réalisateurs eux-mêmes ont expliqué dans des interviews qu’ils ne savaient pas s’ils étaient ou non en train de filmer une scène de viol. Un autre exemple intéressant, c’est celui de Elle de Paul Verhoeven. Beaucoup de critiques féministes ont dit que le film faisait l’apologie du viol. J’entends leurs arguments, mais si on s’attache à la mise en scène, on voit bien que le film épouse l’expérience féminine. Il ne s’agit pas de tomber dans ce qu’on pourrait voir comme une vérité sociologique à traduire à l’écran, mais de se demander comment la caméra retranscrit l’expérience féminine. Et toute expérience féminine, qu’elle suive ou non une réalité sociale, est valable et valide à l’écran. Cela ne veut pas du tout dire que toutes les femmes qui se font violer vont réagir de la même manière que le personnage d’Isabelle Huppert. Mais ce qui est sûr, c’est que Paul Verhoeven empêche d’érotiser les viols dont elle est victime dans le film.
Pourquoi La Leçon de Piano de Jane Campion incarne-t-il particulièrement l’esthétique émancipatrice du « female gaze » ?
Car Jane Campion y invente un langage amoureux non verbal, libéré de l’asymétrie entre désir masculin et féminin. Au-delà du fait que le film raconte l’histoire d’une femme se battant pour obtenir ce dont elle a envie en sortant du patriarcat, Jane Campion invoque une synesthésie pour sortir le spectateur de sa passivité. Son héroïne ne parle pas, mais dès les premières secondes, la musique nous place dans une expérience sensorielle, sonore, corporelle, afin que l’on ne fantasme plus l’héroïne de loin, mais qu’elle habite littéralement notre corps.
À propos de la série de Gregg Araki, Now Apocalypse, vous parlez d’une « égalité des corps » face au « male gaze » : en quoi le regard de Gregg Araki sur la sexualité diffère-t-il de celui, plus inégalitaire selon vous, de Kechiche par exemple ?
Gregg Araki a déconstruit puis reconstruit le male gaze dans un geste conscient. Il éprouve du plaisir à filmer ses personnages de manière égalitaire, sans asymétrie entre corps masculin et féminin. Dans Mektoub, les personnages masculins ne sont jamais filmés comme les femmes. Le corps féminin, parce qu’il est montré du point de vue des hommes, peut être réduit à un gros cul, alors que les corps d’hommes ne sont jamais sexualisés. Un exemple frappant dans Mektoub My Love – Intermezzo : lorsque le héros Amin sort du lit, Abdellatif Kechiche prend soin de voiler son corps d’un drap et détourne la caméra comme pour protéger son héros d’une possibilité d’objectivation. Je pointe l’hypocrisie, de la part de Kechiche et de la critique française, à ne pas voir ce traitement différent des corps selon leur genre.
En quoi Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma déconstruit-il le rapport de force traditionnel entre muse et artiste, pour déployer une égalité des regards ?
Parce que le film nous dit ceci : créer, ce n’est pas voler quelque chose à quelqu’un, c’est un processus de partage et de réciprocité. Céline Sciamma nous propose de repenser avec elle notre façon collective de prendre du plaisir en tant que spectateur, de redéfinir l’amour grâce à un nouveau régime d’images inventif. Non seulement les regards de ses personnages féminins sont actifs entre eux, mais le regard du spectateur l’est aussi. Ayant conscience que le spectateur regarde son film elle le place dans une dynamique qui n’est plus celle du réalisateur tout-puissant et du spectateur passif, mais d’une dialectique entre un créateur et son public, sans prise d’otage, dans un geste généreux et responsabilisant, donc politique. Si le film fait déjà date et a un tel pouvoir de transformation, c’est parce qu’il est devenu un manifeste pour celles et ceux qui veulent plus de représentations d’amours lesbien, mais aussi pour ceux qui veulent sortir des rapports de domination dans l’amour.
Le Regard féminin, une révolution à l’écran d’Iris Brey, Editions de l’Olivier, parution le 6 février
Photographie: Copyright Patrice Normand
Propos recueillis par Léa André-Sarreau


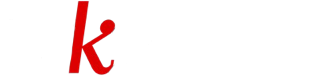 Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2
Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2