En art, l’adage veut que le beau ne supporte pas l’effort, qu’on ne doit jamais voir le travail. Le cinéma, lui, a pourtant très vite décidé d’exposer ses coulisses, de raconter dans des films la petite fabrique bizarre, excitante, merveilleuse ou parfois terrible des images. Des films qui font du plateau de tournage le décor d’une fiction où vrai et faux se mélangent. Le cinéma s’y observe, décortique sa mécanique et nous révèle forcément quelque chose qu’on n’aurait pas dû voir. Comme un magicien révélant ses tours, Gaspar Noé s’amuse ainsi dans à nous montrer la fabrication des images stroboscopiques qui parsèment son œuvre, à filmer les machines, les spots qui se mettent en branle et créent la beauté syncopée de son cinéma.
À l’image de Kirk Douglas dans Les Ensorcelés (Vincente Minnelli, 1953) inventant devant nos yeux par simple manque de moyens les ombres terrifiantes du cinéma d’horreur suggestif, de Gene Kelly et Debbie Reynolds actionnant un à un les éclairages et les artifices d’un plateau de tournage hollywoodien pour que leur valse amoureuse soit plus belle encore (Chantons sous la pluie, 1953) ou du final de Body Double (Brian De Palma, 1985) avec la révélation des trucages laborieux d’un film d’horreur érotico-gore, Noé exhibe l’artifice et la technique, amenant ainsi le spectateur à déconstruire les images et leurs pouvoirs.
FINI DE JOUER
Mais cette mise à découvert du cinéma est surtout un moyen pour lui de se regarder en face. Et souvent, c’est la satire qui prime. De Ça tourne à Manhattan de Tom Dicillo (1995) au dantesque Tonnerre sous les tropiques (Ben Stiller, 2008), la comédie trouve dans les films de plateau un terrain de jeu jubilatoire. Crise des ego, projet impossible, palabres interminables, créateur en panne, tout est réuni pour que le huis clos du tournage devienne un vaudeville explosif. Si Noé lorgne parfois vers ce registre dans Lux Æterna (la caricature du producteur, les pique-assiettes qui traînent, les maquilleurs qui conspirent…), l’autoanalyse prend ici surtout la forme d’un examen de conscience. Ce n’est pas le petit monde du cinéma qui l’intéresse, mais bien ce que le cinéma fait au monde, ce qu’il lui prend, ce qu’il lui doit. Et en particulier aux actrices.

À l’image de Laura Dern, Alice égarée dans les méandres psy d’un rôle dans Inland Empire (, 2007), les métafilms nous font passer de l’autre côté du miroir pour regarder les créateurs comme des créatures. Un freak show qui exhibe devant nous les souffrances, les cruautés et le trouble que l’image glacée prenait bien soin de taire. La longue conversation entre Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg qui ouvre Lux Æterna dit tout. Béatrice raconte le regard sur soi, l’exhibition, la soumission aux desiderata, l’abandon de soi et l’art, le beau comme justification à tout. Mais est-ce bien normal ? Le cinéma s’est toujours posé la question.

En 1940, par exemple, Hollywood Cavalcade d’Irving Cummings raconte les grandes heures du cinéma muet via la trajectoire imaginaire d’une jeune actrice de cinéma burlesque. Dans une scène particulièrement cruelle, le film décrit les humiliations, les chutes, la honte et les rires qui ne consolent pas vraiment. En quelques scènes, Hollywood se regarde consommer un corps, l’utiliser pour de rire et l’avilir pour de vrai. Il faudra attendre les années 1950 et la chute annoncée du grand Hollywood pour que cette autocritique prenne de l’ampleur. D’abord la splendeur mortifère de Norma Desmond, corps vidé par tant de cinéma, qui attend son gros plan imaginaire dans le mythique Boulevard du crépuscule (Billy Wilder, 1951), puis la noirceur totale et inquiétante du Démon des femmes. Dans ce métafilm de 1969, Robert Aldrich décrit le calvaire d’une actrice (Kim Novak) sous le joug d’un réalisateur fou et raconte le trouble entre un rôle et une interprète, le mélange funeste entre la vie et la fiction, pour la beauté de l’art.
« En se regardant, le cinéma révèle sa propre ambiguïté et les rapports de force et domination qu’il génère»
À chaque fois la folie guette, comme dans Irma Vep d’ (1996), avec l’échappée mentale de Maggie Cheung, actrice sans film qui se met soudain à se faire son propre cinéma ; ou dans Nina Wu de Midi Z (2020), avec la dérive de l’héroïne qui perd pied entre fiction et réalité pour refouler son viol par un producteur. Le cinéma expose, détruit, use des corps féminins jusqu’à ce qu’ils craquent. Mais qui craque ? Le personnage ou l’actrice ? C’est le gros plan sur le visage de Romy Schneider dans L’Important c’est d’aimer (Andrzej Zulawski, 1975), sur le plateau d’un film minable. La caméra l’enserre, l’épie, le personnage craque, et soudain c’est Romy elle-même qui semble nous exhorter à ne plus la regarder. Comme si les larmes pour de faux étaient devenues vraies. Soudain, on ne joue plus.

LUTTE DE POUVOIR
Dès lors, en se regardant, le cinéma révèle sa propre ambiguïté et les rapports de force et de domination qu’il génère. Les films de tournage deviennent des examens de conscience de ce pouvoir à l’œuvre. Si de célèbres making of comme Aux cœurs des ténèbres. L’apocalypse d’un metteur en scène, sur le tournage d’Apocalypse Now, ou Lost in La Mancha, et le désastre de Terry Gilliam, témoignent du chaos d’un tournage, les fictions, elles, fabriquent et théorisent ce chaos dans des œuvres à clés.
Lux Æterna décrit ainsi les luttes de pouvoir entre Dalle et son producteur, les conflits avec le chef opérateur et la sempiternelle question de savoir qui est aux commandes. Ce que racontait déjà R. W. Fassbinder – cité par Noé dans le film – dans Prenez garde à la sainte putain (1971). Dans ce film apathique et hystérique, le cinéaste monstre allemand filmait les multiples rapports de dominations et la hiérarchie toxiques qui règnent sur un plateau.
Sorti deux ans plus tard, La Nuit américaine de racontait quant à lui les jeux de dupe d’un petit monde habitué à faire semblant. « Qu’est-ce que c’est que ce cinéma ? […] Ce monde où tout le monde ment ? […] Je le méprise, le cinéma », s’y exclame un personnage. Conclusion terrible. Pourtant quelque chose résiste. Noé, Fassbinder et Truffaut, dans leurs films respectifs, finissent par céder à la fascination des images. Les éclairs qui nous engloutissent à la fin de Lux Æterna sonnent comme un aveu d’impuissance. Le cinéma reprend le dessus, nous laissant exsangues mais alertes. Désormais nous ne sommes plus victimes de l’illusion, mais bien conscient de ce dont elle est faite. La traversée du miroir fait de nous de meilleurs spectateurs.
Image : Gloria Swanson dans Boulevard du crépuscule de Billy Wilder (1951) © Collection Christophel

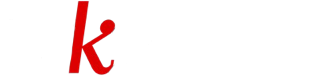 Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2
Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2