Vous critiquez ce que vous appelez le « mythe du déclic » concernant le fait de passer à l’action pour lutter contre la crise écologique. Pourquoi ?
On me pose souvent cette question du déclic, avec l’idée qu’il serait toujours possible de reconstituer, a posteriori, des instants clés de notre histoire ayant mené à notre engagement. Pourtant, il faut faire le deuil de ce grand soir, de ce supposé moment où tout deviendrait clair. Déjà parce que cela ne correspond pas à la réalité, mais aussi parce que ce « mythe du déclic » est dangereux. Celui-ci peut conduire à idéaliser les personnes engagées, à les percevoir comme touchées par la grâce. Ce qui, par ricochet, peut pousser un certain nombre de gens à se dire : « C’est super, les personnes qui s’engagent, mais passer à l’action, ça n’est pas pour moi. » En fait, un tel mythe est souvent quelque chose qui excuse et qui permet l’inaction dans le sens où l’on va attendre ce fameux déclic pour se mettre en mouvement. Or, à partir du moment où l’on est vivant sur une planète dont les conditions de vie sont menacées par tout un système économique et politique, tout le monde a la légitimité pour s’engager.
Nathaniel Rich : «Tout est changement climatique! Et il a déjà des effets sur nous »
Vous affirmez que « l’impuissance est un choix politique qui ne nous bénéficie pas ». Que voulez-vous dire par là ?
On se sent impuissants, c’est normal, mais cette impuissance est choisie et orchestrée par des gouvernements qui maintiennent sciemment la route qui nous mène droit dans le mur. De la même manière que le travail des féministes sur le patriarcat permet de prendre conscience des chaînes invisibles qui nous entravent, j’ai voulu montrer que l’impuissance n’est pas un état de fait mais une construction sociale. Voilà pourquoi je refuse de parler d’inaction climatique : il s’agit plutôt d’une action délibérée de destruction du vivant de la part de nos politiques. On leur a toujours trouvé des excuses : ils ne seraient pas assez au courant de la situation, la tâche à accomplir serait trop grande, etc. Pourtant, on a bien vu, à l’occasion de la crise du Covid, qu’ils étaient aptes à prendre des décisions extrêmement fortes. L’État a été capable en vingt-quatre heures de clouer les avions au sol, au nom d’une urgence qu’il jugeait plus grande. Agir est donc possible, et ne pas le faire relève d’un choix et d’un manque de volonté politique. D’autant que cette organisation de la société, capitaliste et extractiviste, ne profite qu’à quelques-uns, tout en affectant particulièrement les personnes les plus pauvres. Il y a ainsi une double injustice, climatique et sociale : ceux qui sont statistiquement les plus responsables du dérèglement climatique sont ceux qui sont les plus protégés des problèmes dont ils sont la cause. En France, la moitié du taux d’émissions de CO2 est due aux 10 % des personnes les plus riches. Ça n’a aucun sens ! Pourtant, ce ne sont pas elles qui vivent près d’échangeurs routiers ultra pollués ou qui doivent quitter leur pays en tant que réfugiés climatiques.
Vous louez la notion de peur, féconde selon vous en ce qu’elle est « à la genèse des révolutions ». De quelle manière ?
Il est important de réhabiliter la peur dans l’espace public. Du fait d’une lecture patriarcale du sujet, la peur est souvent associée, de façon négative, à la vulnérabilité. Il s’agirait ainsi plutôt d’être rationnel et de ne pas trop parler aux émotions. Pourtant, c’est précisément ça qui est inquiétant : le fait que les personnes décisionnaires ne soient pas émues d’être en train de condamner des espèces entières, et potentiellement les générations futures. On a tous peur de ce qui se passe en ce moment et de ce qui arrivera plus tard. Ne pas le reconnaître, c’est reléguer cette émotion à une chose qui ne serait qu’intime, alors que la peur est précisément un sentiment politique. Il est très important de le revendiquer comme tel : on nous vend la peur comme quelque chose qui crée de l’apathie et qui tétanise, alors qu’elle est en fait une émotion vitale qui nous protège. Si une voiture me fonce dessus et que je n’ai pas peur d’elle, je risque de me faire écraser ! Si j’ai peur, en revanche, je vais tenter de sauver ma peau. Reconnaître que l’on a peur, ce qui est un sentiment sain dans un monde malade, permet de transformer collectivement cette émotion en outil d’action politique.
RÈGLE DE TROIS · Salomé Saqué, quelle cinéphile êtes-vous ?
Vous écrivez que vous avez souvent l’impression de vivre dans le film Don’t Look Up. Déni cosmique (Adam Mckay, 2021)… Pourriez-vous préciser votre pensée ?
Par plusieurs aspects, ce film n’est à mon sens pas tout à fait juste, mais je me rappelle très bien le passage où le personnage incarné par Jennifer Lawrence, invité sur un plateau de télé, alerte sur le fait que la planète est sur le point d’être détruite. En face d’elle, les animateurs dédramatisent la situation. Je me suis dit : « Mais c’est ce que je vis constamment ! » À la télévision, on nous place face à des personnes ou à des journalistes qui essaient de nous challenger, d’exprimer une vision contraire à la nôtre. Comme si l’urgence climatique était une opinion ! Le tout en nous demandant de ne pas trop apeurer la population, ce qui est très grave.
Comment le soulèvement écologique que vous appelez de vos vœux pourrait-il advenir ?
C’est une question à laquelle je n’ai pas de réponse. Mon livre n’est pas programmatique : le soulèvement est quelque chose qui doit être vécu et discuté démocratiquement, et pas décidé dans des livres. Ce que j’ai voulu faire, en revanche, c’est faire gagner du temps à un certain nombre de personnes. Je raconte en cent soixante pages mon parcours personnel, mais surtout je présente les penseurs et les idées auxquels j’ai mis des années à avoir accès, et qui m’ont permis de sortir de mon impuissance. À travers ce court livre, je souhaite montrer qu’il est nécessaire et possible de se soulever, que ce soulèvement appartient à tout le monde et que nous avons encore une possibilité d’action. J’espère ainsi donner envie aux personnes qui me liront de renouer avec leur puissance. Pas une puissance qui écrase, pas celle des puissants d’aujourd’hui, mais une puissance qui nous réalise et qui nous permet d’accomplir notre être. En fait, un soulèvement peut à la fois être intime et politique. Et c’est ce qu’il y a de très beau là-dedans : une société qui se soulève renvoie à une nouvelle manière de voir le monde, qui passe par une indignation nécessaire et vitale. À partir du moment où l’on voit le monde à travers ce prisme-là, à nous de nous demander quels talents, quelles énergies et quels privilèges l’on pourra mettre au service de ce soulèvement-là.
Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé, le 28 mars, engager la dissolution du mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre, le tout dans un contexte de répression du mouvement social. Qu’est-ce que cela vous inspire ?
J’ai récemment signé une tribune intitulée « Nous sommes les Soulèvements de la Terre », qui explique que l’on ne peut pas dissoudre un mouvement : comme le dit le texte, un mouvement est par définition quelque chose de « multiple et vivant ». Quand bien même Gérald Darmanin voudrait le dissoudre – ce qu’il ne pourra pas légalement faire de toute façon –, on repousserait partout ailleurs. Cela dit, cette criminalisation du mouvement écologiste montre qu’ils ne nous laisseront pas nous soulever gentiment. Cela met donc en lumière le fait que l’on va avoir besoin d’être rejoints par un maximum de personnes. C’est de cette manière que l’ordre établi n’aura pas d’autre choix que de céder.
« Camille Étienne, militante écologiste. » Rencontre modérée par Olivier Pascal-Moussellard (Télérama), suivie d’une signature le 23 mai au mk2 Bibliothèque à 20 h
tarif : 15 € | étudiant, demandeur d’emploi : 9 € | − 26 ans : 5,90 € | carte UGC/mk2 illimité à présenter en caisse : 9 € | séance avec livre : 19 €
• Pour un soulèvement écologique. Dépasser notre impuissance collective de Camille Étienne, (Seuil, 176 p., 18 €)
Portrait © Manon Cha

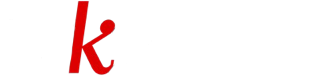 Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2
Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2