Un bunker chic et silencieux assis sur les collines de Los Angeles. Un couple – Fred, saxophoniste dépressif (Bill Pullman) et Renée (Patricia Arquette, vénéneuse) – reçoit une cassette vidéo de la façade de leur maison. Puis une seconde, filmée depuis leur chambre, où on les voit dormir. Puis une dernière, qui suggère, dans un déferlement de sang, que Fred aurait assassiné Renée.
Si Lost Highway commence par une relecture formaliste du film noir hollywoodien, il n’emprunte ce chemin que pour mieux nous égarer dans sa seconde partie, bifurquer vers les rivages de l’inconscient. Incarcéré pour le meurtre de sa femme, Bill est mystérieusement libéré sous le nom de Pete Dayton (Balthazar Getty) et Renee réapparaît, telle une héroïne hitchcockienne, sous les traits de la blonde Alice (Patricia Arquette bis)…
Crise identitaire d’un assassin schizophrène, délire d’un homme rongé par la culpabilité, variation sur l’obsession pour une femme fatale, la jalousie maladive, la mort d’un amour ? Si David Lynch a disséminé quelques indices nébuleux sur la genèse du film – il serait inspiré de l’affaire O.J Simpson, sportif adulé des Américains, devenu une idole déchue après avoir été accusé puis innocenté du meurtre de sa femme -, on aurait tort de vouloir percer son secret cauchemardesque, au risque de déflorer son étrange beauté.
Car le génie de Lynch est d’arriver à captiver le spectateur malgré l’opacité de son récit, de le prendre en otage par le vertige de la forme. C’est une scène de sexe d’une froideur clinique, où se joue en avance, grâce à un floutage discret et au désaxement de la caméra, le dédoublement à venir du personnage, absent à lui-même dans ce qui devrait être un grand moment d’érotisme. Ou encore un travail sophistiqué du chef opérateur Peter Deming sur le noir des décors, des couloirs, qui se teintent d’une plus grande obscurité à mesure que les personnages laissent divaguer leurs pulsions de vie et de mort.
« Mulholland Drive » de David Lynch aurait dû être une série spin-off de « Twin Peaks »
A mesure que le sens du film se dérobe, sa toile esthétique se tisse et se précise, tirant vers l’abstraction totale – l’image liminaire du générique, où le bitume de la Vallée de la Mort défile sur le I’m Derange de David Bowie, pour ne devenir qu’une ligne jaune imprimée sur la rétine – ou au contraire, vers des fulgurances figuratives – ces flashs musicaux presque épileptiques, où Bill semble possédé par son saxo en contre-plongée.
Par ces sortilèges visuels, cette façon de modeler la bizarrerie du quotidien en énergie morbide et sensuelle, le film ouvrait non seulement à son successeur Mulholland Drive (2001), mais aussi à tout un héritage thématique et visuel. De l’anti-héros de Fight Club, symbole du revers sombre de l’Amérique, aux diptyques narratifs qui utilisent une césure pour se réinventer en chemin (Tropical Malady d’Apichatpong Weerasethakul), sans oublier la cassette VHS, devenu objet déclencheur de la paranoïa dans l’imaginaire (Caché de Michael Haneke), Lost Highway se pose comme une matrice inoubliable, un film-paradigme qui recèle autant les obsessions de son réalisateur que celles de son époque.
Lost Highway de David Lynch, en avant-première restaurée à la 14e édition du Festival Lumière de Lyon (du 15 au 23 octobre) le 15 octobre, ressortie en salles le 7 décembre (Potemkine Films)
L’archive du déjeuner : dans les coulisses de la saison 3 de « Twin Peaks » de David Lynch

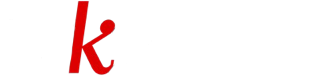 Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2
Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2