La Fracture vient d’une nuit que vous avez passée aux urgences, après un accident. Mais comment cet événement personnel a-t-il donné lieu à un film aussi politique et étonnamment drôle ?
Quand m’est arrivé cet accident domestique stupide, j’étais dans un état d’hypervigilance. Je cherchais l’inspiration. Je venais de faire deux films d’époque dont l’un adapté d’un roman de Christine Angot [Un amour impossible, ndlr] et spontanément j’ai eu envie de regarder mon monde en face. La précision de Christine Angot sur les années 1950 m’avait guidée tout le long de ce film, et je voulais voir si je pouvais retrouver ce regard sur ce qui se passait aujourd’hui. On était en 2018 et on sentait bien que la colère montait, on était au bord d’un truc qui allait exploser. Le problème, c’est qu’aujourd’hui les images sont omniprésentes. Qu’est-ce qu’on peut raconter d’autre que ce que le documentaire, les reportages, les réseaux sociaux captent si vite ? Spontanément, j’ai eu envie d’un film à la Nanni Moretti. Un film dans l’époque, un film qui la regarderait droit dans les yeux, mais avec suffisamment d’ironie et d’intime pour pouvoir sourire de tout ce qui ne va pas. Je voulais un film qui sorte du choc, de l’émotion, de tout ce que ces images prises sur le vif nous balancent à la gueule. Faire par la fiction un pas de côté pour sortir de l’immédiateté. La nuit que j’ai passée aux urgences m’a offert tout ça sur un plateau.
« La Fracture » de Catherine Corsini : folle nuit
Pourquoi cette nuit a-t-elle déclenché chez vous l’envie d’un film ?
Parce qu’il y avait tout ! Déjà, moi, en pleine engueulade avec mon amie, qui tombe et me fais mal. Rien que ça, le rapport entre le couple et le corps, y a quelque chose qui m’amuse là-dedans. Mais par-dessus ça le politique s’invite. On est le soir de l’acte IV des « gilets jaunes » [le samedi 8 décembre 2018, ndlr], ça prend une ampleur énorme dans Paris et tout se mélange. Je suis shootée aux médicaments sur mon brancard et je regarde autour de moi. La télé qui crache et montre les manifestations, les violences policières, les gens en souffrance, les urgences délabrées, le personnel à bout… Je sens qu’il y a là l’arène pour raconter l’état de la France. Je rêvais d’un film en huis clos. D’un film qui m’oblige à la confrontation. Même shootée aux antidouleurs, sur mon brancard, j’ai senti le déclic et l’excitation qui me prend à chaque fois que je sais que je tiens l’idée d’un film. Ensuite, il a fallu s’attaquer à tout le travail de fiction et de point de vue.
Quand on réalise un film aussi contemporain – donc proche de la réalité du spectateur –, s’inquiète-t-on encore plus de la justesse du point de vue ?
Je ne suis pas sociologue, ni politologue. Je ne pouvais raconter cet état du monde que de mon point de vue. D’où la nécessité de partir de mon intimité pour aller vers les autres. Je crois que c’est toujours important de dire et d’assumer d’où l’on parle. Je ne peux pas foncer tête baissée dans le social, étaler la misère et la colère du monde sur l’écran. Ken Loach peut se le permettre parce qu’on sait d’où il parle. J’ai vite compris qu’il fallait que j’assume mon regard un peu perdu, pas très sûr, mes préjugés, pour permettre au film et aux personnages d’exister. Pour pouvoir rire, il fallait que ça passe par la satire de moi-même. Et Valeria Bruni Tedeschi m’a aidée à trouver le bon équilibre [l’actrice joue Raf, une autrice de BD qui, en pleine rupture avec sa compagne, s’est blessée au bras lors d’une chute et attend indéfiniment son tour aux urgences, ndlr]. Ce n’est pas un film « avec un point de vue » comme on le dirait d’un film à thèse. C’est justement, je crois, l’inverse. C’est un film qui doute, qui ne sait pas, et qui, par le biais de ce pas de côté qu’est la comédie, décentre le regard et remet tout le monde au même niveau.

Pourquoi la comédie est-elle si utile pour raconter l’époque, selon vous ?
Parce qu’elle empêche tout didactisme. Il n’y a rien de pire que ça. La comédie refuse le manichéisme. Avec La Fracture, je veux montrer combien la société érige les gens les uns contre les autres, nous explique sans cesse que tout est divisé, irréconciliable… Les bobos versus les « gilets jaunes », voilà ce qu’on nous raconte à longueur de journée. Deux caricatures que je voulais confronter à la réalité, et montrer comment ces mondes, au fond, peuvent se rencontrer. La comédie part du préjugé et t’emmène ailleurs. Et pour moi, ça, c’est politique. Dépasser l’immédiat pour aller vers la complexité, la nuance.
« La comédie part du préjugé et t’emmène ailleurs. Et pour moi, ça, c’est politique. »
Mais la comédie ici s’appuie aussi sur un aspect quasi documentaire de l’état de l’hôpital public. Comment marie-t-on l’ironie à la réalité sociale, sans que cela devienne obscène ou malvenu ?
J’ai beaucoup travaillé sur les personnages. Pour que la comédie naisse, il fallait qu’ils existent. Que la caricature soit dans la façon dont ils se pensent les uns par rapport aux autres, pas dans l’œil du spectateur. Prendre le temps par la fiction de sortir des cases. Je ne voulais pas, par exemple, réduire le routier à sa colère [le personnage de « gilet jaune » joué par Pio Marmaï, ndlr]. Je voulais qu’on identifie son quotidien, la nécessité pour lui de retrouver son camion. Même chose pour la soignante [jouée par Aïssatou Diallo Sagna, ndlr]. Elle a une vie hors de sa fonction. C’est ça, la réalité sociale. Les gens ne sont pas des fonctions. Et pourtant le monde voudrait les réduire à ça. La psychologie, ça m’ennuie. Ces personnages sont des énergies, des forces. Et je voulais réussir à capter ça. C’est ça, la réalité du monde. Bien sûr il y a la violence – et elle est dans le film –, mais il y a aussi tout ce qui fait qu’on lutte contre, qu’on vit avec, qu’on y répond…

On a l’impression que vous avez conçu La Fracture comme un film d’action…
Exactement. Je refuse de m’apitoyer sur ces personnages, de faire du mélo. Je voulais des personnages constamment dans la vie, dans l’action. Pour préparer le film, j’ai revu Un après-midi de chien de Sidney Lumet (1975) et Assaut de John Carpenter (1978), ça m’a permis d’oser me débarrasser de la psychologie. Surtout, je savais qu’à la mise en scène je devais amener l’énergie de l’affrontement. La plupart du temps, ils sont immobilisés, assis, allongés, et pourtant je voulais que ça explose, que ça s’affronte, que la tension qu’on vit chaque jour éclate à l’écran. Je voulais une caméra très mobile, pour éviter le côté « petit théâtre », et donner le sentiment d’une succession d’accidents. Ces personnages sont tous victimes d’un truc qui rend dingue : l’empêchement. Ils veulent simplement bosser, retourner chez eux, mais ça bloque. Devant l’impuissance, le corps prend le relais. La colère monte. Et, forcément, l’énergie déborde. La société fabrique des conflits, oppose les gens, les isole les uns des autres pour éviter qu’ils ne soient solidaires. Je voulais montrer ça. La colère des uns va faire écho à la colère des autres. Il y a quelque chose de très fort qui se passe à l’hôpital, on s’y sent tous démunis, en fragilité. Et c’est là que la rencontre est possible.
Cette énergie vient aussi de la direction d’acteur, très physique, quasi burlesque par moments. Comment avez-vous travaillé avec eux ?
Avec Valeria, on s’était loupées à l’époque de La Nouvelle Ève. Je suis très heureuse qu’on se soit retrouvées pour ce film. Tout de suite, j’ai senti que ce type de personnage qu’elle appelle « sans surmoi » lui parlait. On a eu très peu de temps pour préparer le tournage. Je voulais que ce soit physique pour eux, qu’ils se sentent en alerte en permanence. Même si le film était très écrit, je les ai beaucoup incités à l’improvisation. Je voulais que ça déborde, que ça dérape, qu’ils soient constamment dans la surprise. Sur l’aspect burlesque, ma hantise, c’était le trop, que ça écrase tout. Il fallait canaliser l’énergie. Pour le personnage de Valeria, il fallait pousser un peu les curseurs, mais qu’on sente en même temps sa douleur, sa tristesse… C’est pour ça qu’on commence vraiment le film avec elle, plutôt sur une tonalité émouvante, fragile, pour ensuite permettre que ça éclate. Valeria adore essayer des tonalités très différentes pour une même scène. C’était très jubilatoire au montage parce qu’on pouvait vraiment ciseler la tonalité du film. Et face à elle, Marina Foïs va chercher quelque chose de plus dur, de plus en retrait, qui, je trouve, amène quelque chose de nouveau. C’était important pour moi que ce couple existe tout de suite à l’écran.

Vous filmez un couple de femmes au centre d’une comédie, sans que jamais l’homosexualité ne soit le sujet du film. C’est plutôt rare…
Oui, et c’est pour ça que j’étais très heureuse de recevoir la Queer Palm à Cannes. Ce sont deux héroïnes, un couple comme un autre, au bord de la rupture. Deux femmes qui s’aiment, et alors ? Je voulais montrer une famille aussi. Ce fils, né d’une autre histoire d’amour, qui unit ces deux femmes. C’est important de sortir les couples homos de leur statut de victimes au cinéma. De montrer le quotidien, d’en faire des personnages comme des autres. Pour moi, filmer Valeria Bruni Tedeschi et Marina Foïs en couple sans que ce ne soit jamais le sujet, c’est politique.
Est-ce que vous revendiquez La Fracture comme un film engagé ?
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis une femme engagée, mais faire un film engagé, je ne sais pas si c’est mon intention. Je ne réalise pas un film à thèse. Je ne dis pas aux gens quoi penser. Je crois profondément que la fiction nous permet de prendre du recul, de nous poser des questions. Et pas forcément d’avoir des réponses. On est dans une ère où tout est épidermique. Le temps du cinéma appelle, je crois, à moins de certitudes. J’ai des convictions politiques, et le film fait l’état des lieux d’une société divisée, parle des violences policières, de l’état honteux de l’hôpital public en France. Mais je crois que, ça, tout le monde en a conscience aujourd’hui, non ? Reste que la fiction permet peut-être de nous réconcilier. Je crois aux vertus du rire, à l’empathie, à l’identification à des personnages différents de soi. Le cinéma c’est, profondément, un outil du vivre ensemble.
La Fracture de Catherine Corsini, Le Pacte (1 h 38), sortie le 27 octobre
Portrait (c) Marie Rouge pour TROISCOULEURS
Images (c) Le Pacte

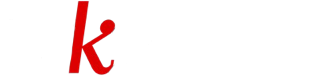 Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2
Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2