Comment vous sentez-vous à l’idée de recevoir ce prix ?
C’est irréel. Vous savez, personne ne reconnait jamais la contribution des producteurs. Locarno est vraiment unique, c’est un festival qui promeut des voix originales du cinéma. Ça me permet de regarder dans le rétro et de me dire « wow, j’ai fait tout ça ! » C’est magique.
Commençons justement par vos débuts. Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire de la production ?
Je n’ai pas eu de vocation. Quand j’étais jeune [Stacey Sher est née en 1962, ndlr], il n’y avait pas vraiment de couverture du divertissement. Entertainment Tonight [émission d’infos people diffusée quotidiennement à la télé américaine depuis 1981, ndrl] n’existait pas. Il y avait quelques critiques importants, comme Pauline Kael [légendaire critique étatsunienne, qui a écrit dans le New Yorker de 1968 à 1991, ndlr] puis les Paulettes [les disciples de Pauline Kael, majoritairement des hommes, qui reprirent son flambeau dans le domaine de la critique dans les années 1990, ndlr], ou encore les Cahiers du cinéma.
Lotte H. Eisner et Pauline Kael : deux femmes d’influence
Mais j’ai grandi à Fort Lauderdale, en Floride. Je n’avais pas accès aux films de Fellini, je pouvais à peine voir des extraits de La Dolce Vita à la télé. C’est seulement quand j’ai déménagé en Californie pour mon diplôme de fin de lycée que j’ai pu voir des films internationaux. En même temps, c’était une époque bénie pour le cinéma américain. Mon père adorait les films, il m’a transmis cette passion. J’adorais la lecture, la musique et le cinéma. Mais j’étais aussi fan de sport. Je pensais que c’était dans ce domaine que j’allais travailler, dans la diffusion du sport. Sauf que j’ai fait un stage dans ce milieu et j’ai trouvé ça trop sexiste. J’ai donc opté pour le milieu très inclusif des films et de la télé… – c’est ma blague préférée. J’ai eu un prof, Douglas Gomery, qui était curateur à l’American Film Institute et donnait des cours à l’Université du Maryland, où j’ai commencé mes études supérieures. Un jour, il m’a prise à part et m’a dit : « Vous, vous avez l’air de vraiment aimer le cinéma. Il y a un programme pour les diplômés à l’USC, le Peter Stark Motion Picture Producing Program, vous devriez postuler. » C’est ce que j’ai fait, et je l’ai miraculeusement obtenu alors qu’il n’y avait que vingt-cinq étudiants, et pas tant qui sortaient à peine de l’école. Ça a changé ma vie.
Vous avez commencé votre carrière dans la production grâce au premier film de Chris Columbus, Nuit de folie (Adventures in Babysitting en VO, 1987), le premier projet produit conjointement par Debra Hill, la principale collaboratrice de John Carpenter, et Lynda Obst. Est-ce que le fait que ce soient des femmes vous a aidé à prendre confiance en vous en tant que productrice ?
En fait, j’ai travaillé pendant toutes mes études. J’ai commencé dans le vidéoclip, j’en ai produit parmi les tous premiers. C’est comme ça que j’ai rencontré le scénariste qui a écrit Adventures in Babysitting, pendant la deuxième année à la fac. Tous les cours se passaient le soir parce que nos intervenants travaillaient dans l’industrie la journée. Il y avait un programme extraordinaire dirigé par Art Murphy, qui travaillait pour Variety et a été la première personne à écrire sur le business à Hollywood. Il faisait des reportings du box-office à l’époque où personne ne s’y intéressait, il analysait les bénéfices trimestriels des boites de production… Il avait été statisticien à l’armée et avait une large vision du cinéma. J’ai eu beaucoup de chances de pouvoir être dans son programme.
Donc, en deuxième année, j’ai bossé comme assistante pour quelqu’un qui travaillait pour le studio TriStar [derrière, entre autres, Terminator 2, Godzilla ou Basic Instinct, ndlr]. Là-bas, il y avait une productrice très gentille avec moi. Elle m’a dit : « Quand tu sortiras de l’école, si tu as un job dans le viseur, je passerais un coup de fil pour t’avoir un entretien ». Elle a tenu parole. J’ai pu rencontrer Debra Hill et Lynda Obst après mon diplôme, alors qu’elles étaient sur le point de produire un film, mais elles me trouvaient trop inexpérimentée. Elles voulaient me prendre à l’essai, elles avaient quand même besoin de quelqu’un. Pendant cette période, je leur ai apporté le scénario de Adventures in Babysitting, c’est comme ça que j’ai décroché le job.

Nuit de folie de Chris Colombus
Debra Hill était vraiment la papesse du cinéma indépendant. Halloween [1978, ndlr], qu’elle a produit et coscénarisé avec John Carpenter, a bâti le modèle du genre. Elle m’a tout appris de la philosophie à avoir sur un plateau et de la manière de produire. Je lui en serai éternellement reconnaissante. Linda est très forte pour développer des histoires et m’a donné une rigueur implacable dans la manière d’approcher le storytelling.
Masterclass de John Carpenter : l’horreur tranquille
En 2006, l’actrice Geena Davis et l’universitaire Stacy Al Smith ont publié une étude à l’USC à propos de l’inclusion [l’étude porte sur la représentation de genres dans les films pour enfants, ndlr], tirant comme conclusion que vous ne pouvez pas être ce que vous ne voyez pas. Quand j’ai grandi, les seuls jobs visibles pour les femmes étaient productrices ou actrices. Je ne pouvais donc pas imaginer un monde où je pourrais faire autre chose dans le cinéma.
« À un moment, on s’est allongées à plat ventre au bord de l’eau et on a agité des planches de natation pour faire bouger l’eau. Pour moi, c’est ça la production »
Dès vos premières années en tant que productrice, vous avez participé à un nombre exceptionnel de films devenus des classiques : Pulp Fiction de Quentin Tarantino (1994), Matilda de Danny DeVito (1996), Bienvenue à Gattaca d’Andrew Niccol (1997), Erin Brockovich de Steven Soderbergh (2000)… entre beaucoup d’autres ! Comment expliquez-vous ce succès fulgurant ?
Je dois être chanceuse, je ne sais pas… Bon, il faut avouer que j’adore ce que je fais. Je n’en reviens pas de pouvoir chaque jour raconter des histoires et faire des films, je suis très consciente de ma chance. Après, c’est aussi beaucoup de travail et parfois de peines de cœur. J’ai toute une communauté de scénaristes et de cinéastes rencontrés tôt dans ma carrière avec laquelle je partage une passion du cinéma, on aime les mêmes films, on se montre des choses, on fréquente les salles ensemble. Et puis, travailler puis être l’associée de Danny DeVito et Michael Shamberg [dans la société Jersey Films, qu’elle a intégrée à la suite de Hill/Obst Productions, ndlr] a été d’une très grande aide. Quand j’aimais quelque chose, ils me soutenaient à fond.
Cette philosophie s’est traduite avec Garden State de Zach Braff, qui fête ses vingt ans cette année et a été produit par Pam Abdy, la présidente de Jersey Films. J’ai appliqué avec elle ce qu’on m’avait appris, la philosophie de notre boîte, qui était de faire confiance à la vision de ses employés. Pam était passionnée par la vision de Zach, au point de me dire : « C’est l’histoire de ma vie. C’est ma génération. » On lui a dit : « Fonce. » Cette boîte a été un véritable safe space pour moi.

Garden State de Zach Braff
Quels sont vos secrets pour bien produire un film ? Pour lui permettre d’atteindre le maximum de son potentiel ?
Je crois que le secret, c’est de se dire qu’il n’y a pas de tâche trop grosse ou trop petite. J’ai passé des weekends entiers à essayer de dénicher des perruques perdues par le département des costumes, ou à trouver comment faire prendre un avion de nuit à quelqu’un. Quand j’ai fait Bienvenue à Gattaca, on a eu une galère. Dans la scène finale, Ethan Hawke et Loren Dean [qui sont frères dans le film, ndlr] font la course en nageant vers le large. On l’a filmée en deux fois. La première partie dans l’océan, et l’autre dans une piscine car on ne pouvait pas s’offrir un bassin avec une machine pour faire des vagues. On n’était pas sur un gros budget. Quelqu’un nous a dit : « Il suffit de mettre un charriot élévateur dans la piscine et de bouger la plateforme de haut en bas, ça fera des vagues. » On s’y met, on met le charriot dans la piscine. Là, la machine ne fonctionne pas du tout. Sauf qu’on doit toujours parvenir à faire ces vagues ! Alors, à un moment, la productrice exécutive, Georgia Mendez, et moi, on s’est allongées à plat ventre au bord de l’eau et on a agité des planches de natation pour faire bouger l’eau. Pour moi, c’est ça, la production. Pas de job trop petit ou trop grand.
Un autre secret, c’est qu’il faut vraiment aimer ça. Mon ex-partenaire, Michael, avait l’habitude de dire qu’il y a deux genres de personnes qui réussissent : ceux qui aiment les films et ceux qui aiment l’argent. Je suis tombée dans la catégorie de ceux qui aiment les films. J’ai toujours voulu raconter des histoires qui parlent aux spectateurs et bosser avec des cinéastes qui voulaient toucher le public, parce que j’ai eu la chance de grandir à une époque où les réalisateurs, même dans le genre de la comédie, pouvaient intéresser et divertir de plein de manières différentes. J’ai envie de faire des films qui parlent à autant de personnes que possible.
A votre avis, pourquoi le cinéma indépendant américain était aussi prolifique dans les années 1990 ?
Je pense que les choses sont cycliques. Les blockbusters des années 1980 sont la synthèse naturelle des films des 1970s, ceux que les réalisateurs ayant grandi à l’époque vénéraient. Je crois aussi que, dans les années 1990, les gens qui dirigeaient les studios étaient encore très investis, ils ne pensaient pas qu’il fallait forcément faire un home run [dans le sens de faire beaucoup de bénéfices, ndlr] avec chaque film. C’était une époque de grâce pour certaines grandes sociétés de production. Aujourd’hui, c’est ce qui se reproduit avec des entreprises comme A24. C’est devenu une marque et ils le méritent. Ils font les bons choix, soutiennent de grands auteurs, des voix originales, et le résultat, c’est que les gens remarquent leur nom aux génériques des films.
Vous avez produit trois films de Quentin Tarantino : Pulp Fiction (1994), Django Unchained (2012) et Les Huit Salopards (2015). Pourquoi pas tous ? Vous êtes par exemple spécialement remerciée dans les crédits des Kill Bill (2003 et 2004)…
Le timing, là où nous en étions dans nos vies… Ses projets, les miens. Mais quand ça tombe bien, ça tombe vraiment bien.

Pulp Fiction de Quentin Tarantino
5 anecdotes tirées de « Cinéma Spéculations », l’autobiographie de Quentin Tarantino
Les films de Tarantino étaient coproduits par Harvey Weinstein, qui a été, pendant des décennies, un des plus influents leaders du cinéma américain à travers ses sociétés de production et de distribution Miramax et The Weinstein Company. Comment avez-vous vu l’industrie changer depuis sa chute en 2017, qui a permis de relancer avec force le mouvement Metoo ?
J’ai l’impression qu’il y a plus de liberté et moins de formules toutes faites dans ce que Miramax est devenu, et ce qu’est devenue la Weinstein Company. Le cinéma indépendant a connu beaucoup de bifurcations. On a vu ce que les gens se sont mis à faire pour gagner des Oscars. L’an dernier, la tendance s’est de nouveau renversée : les films nommés aux Oscars n’avaient pas forcément connu un grand succès commercial. J’ai grandi à une époque où les films nommés pouvaient à la fois être des films indés et des grands succès populaires. L’année où on a été nommé pour Django, ou l’année d’Erin Brockovich, ou bien l’année de Pulp Fiction. L’année d’Erin Brockovich, seul un film parmi les cinq nommés [dans la catégorie meilleur film, ndlr] n’avait pas dépassé cent millions de dollars de recettes. Aujourd’hui, il y a A24, Neon, Focus. Il y a des films qui parviennent à enjamber la barrière [des films d’auteurs qui rencontrent un large public, ndlr]. C’est aussi une question de cinéastes. Dans les années Jersey Films, on rencontrait des gens qui voulaient faire des films à succès. Ca n’enlève rien à leur talent, certains artistes cherchent simplement à peindre sur la plus grande toile possible pour qu’un maximum de gens puissent voir leur œuvre.
A votre avis, quel impact a le mouvement Metoo sur l’industrie ? Est-ce que ça encourage les femmes à devenir réalisatrices ?
Je pense que le mouvement Metoo et la place des femmes dans la réalisation sont deux choses différentes. A chaque fois qu’une réalisatrice réussit, ça envoie le message que les femmes peuvent faire ce job. Notre industrie est mue par la réussite, la réussite artistique, créative, financière. J’espère sincèrement que le message derrière Barbie [2023, ndlr] n’est pas : « Vendons plus de jouets ! » Mais : quand on a une réalisatrice aussi singulière que Greta Gerwig et une équipe avec une vision comme celle de Margot Robbie [qui a coproduit le film en plus d’en jouer le rôle-titre, ndlr], c’est ça qui fait l’alchimie du cinéma. Notre business est fait de risques. Il y a cette célèbre phrase de William Goldman en ouverture de son livre Adventures in the Screen Trade [un livre sur Hollywood écrit par l’écrivain et scénariste de Marathon Man et publié en 1983, ndlr] : « Personne ne sait. » Si on avait la recette, tous les films seraient des hits. Sauf qu’on n’en sait rien. Je trouve ça encourageant, au même titre que je trouve encourageant que les femmes ne se voient pas proposer tous les films qui parlent de femmes.
Aujourd’hui, qu’est-ce qui vous stimule dans votre métier ? Quels genres de projets vous donnent envie de produire ?
Eh bien, je crois que je continue d’être excitée par le talent. Scott Beck et Bryan Woods ont écrit A Quiet Place, je viens de travailler avec eux sur leur film Heretic [film d’horreur avec Hugh Grant et Sophie Thatcher dont la sortie en salles françaises est prévue pour le 4 décembre, ndlr], ce sont des scénaristes et des conteurs de génie. Quand on rencontre quelqu’un qui a un point de vue original, ça fait toute la différence. Mon Dieu, j’adorerais travailler avec Celine Song [réalisatrice de Past Lives, 2023, ndlr]. Ou encore Joachim Trier : Julie en 12 chapitres [2021, ndlr] m’a dévastée, c’est selon moi un des meilleurs films de ces dix dernières années.
Vous commencez à comprendre que, pour moi, c’est une question de voix… J’espère qu’un jour, on parviendra à adapter Crying in H Mart, le livre de Michelle Zauner [un essai publié en 2021 et devenu un bestseller aux Etats-Unis, qui porte sur la relation de l’autrice, musicienne américaine, à sa mère sud-coréenne, décédée d’un cancer du pancréas, ndlr]. Elle vit actuellement en Corée du Sud et écrit son nouveau livre. Si tout va bien, Jason Kim et moi en produirons l’adaptation, que Michelle réalisera quand elle sera prête. Le tout, c’est de trouver des gens qui ont une bonne histoire à raconter. On est des storytellers, n’est-ce pas ?

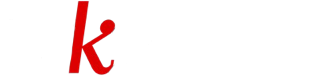 Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2
Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2