On sent dans votre film la volonté de sortir l’extermination des Juifs des livres d’histoire.
Oui, quelque part, on a l’impression de faire face à un mythe, et je pense que cela ne va pas dans le sens de la perception innée de ce qu’ont pu être les camps. Dès le début du projet, on avait la volonté, avec mon équipe, de faire le portrait d’un homme, c’est-à-dire de mettre l’humain au centre du cadre, dans tous les sens du terme, et de donner une dimension humaine à quelque chose qui, trop souvent, est perçu comme une expérience presque hors du temps, de l’espace et de l’humanité.
À quel point cet épisode de l’histoire vous touche-t-il personnellement ?
En Hongrie, en l’espace de sept ou huit semaines, à peu près 500 000 personnes ont été déportées, majoritairement envoyées à Auschwitz-Birkenau pour être gazées. C’est un record. On est à l’été 1944 ; le IIIe Reich est en train de perdre la guerre, mais il ne ménage pas ses efforts pour tuer le plus de Juifs possible. Parmi ces 500 000 personnes, il y avait pas mal de gens de ma famille. C’est donc quelque chose qui était présent dès mon enfance.
Saul, le personnage principal, est membre d’un Sonderkommando, ces unités composées de prisonniers contraints de participer à la « solution finale ». Pourtant, vous choisissez de ne jamais montrer le moment précis de l’extermination. Pourquoi ?
On fait le portrait de Saul, on le suit pendant une journée et on va uniquement là où il va. Ce principe du point de vue unique nous a guidés pendant tout le film. Or, les membres des Sonderkommandos n’entrent dans la chambre à gaz qu’après que le gazage a été effectué.
Au début du film, Saul croit reconnaître, parmi les cadavres qu’il sort de la chambre à gaz, celui de son fils. Cet événement semble le ramener à la vie, le reconnecter avec ses émotions…
Exactement. Les membres des Sonderkommandos sont comme des morts, ils ont vécu des traumatismes indicibles. Une étincelle se produit quand Saul voit le corps de cet enfant. Tout l’enjeu du film, c’est de raconter cette voix intérieure qui naît en lui.
La quête de Saul pour récupérer le corps de l’enfant et lui offrir une sépulture l’amène à croiser un groupe de prisonniers qui préparent une évasion. L’un d’eux reproche à Saul, qui refuse de les aider, de préférer un enfant mort aux vivants. Était-ce important de ne pas faire de Saul un héros ?
Oui, il y a des héros dans le film, mais ce ne sont pas eux qu’on suit. Saul est un homme faillible et ordinaire. Sa quête n’a de sens que pour lui, pas pour les autres personnages, mais j’espère qu’elle a un sens aussi pour le spectateur.
Le film est très documenté. Il s’appuie notamment sur l’ouvrage Des voix sous la cendre. Manuscrits des Sonderkommandos d’Auschwitz-Birkenau (Calmann-Lévy, 2005). Pouvez-vous nous en parler ?
Tout ce qui est dans le film repose sur des faits réels et historiques, comme la préparation de l’insurrection, l’organisation des Sonderkommandos, le fonctionnement du camp… J’ai découvert ce livre il y a plus de dix ans. Il rassemble des manuscrits rédigés par des membres de Sonderkommandos affectés au crématoire du camp d’Auschwitz-Birkenau. Ces écrits ont été enterrés par leurs auteurs, qui savaient qu’ils allaient se révolter et qu’ils avaient peu de chances de survivre. Ils ont été retrouvés après la guerre. En les lisant, j’ai été transporté dans le présent de ces hommes. J’ai voulu donner au spectateur la possibilité de faire l’expérience viscérale de la limitation individuelle et de la souffrance humaine au milieu de l’univers concentrationnaire ; faire naître une perception intuitive de la frénésie chaotique du camp, de l’impossibilité pour l’individu d’anticiper le moment d’après.
Cette volonté de proposer une expérience immersive au spectateur passe par un parti pris formel très original : à l’exception du personnage principal, tout est flou dans l’image.
Le cinéma, pendant des décennies, a institué des codes pour raconter des histoires de fiction pendant la Shoah, des codes qui ont contribué à figer la perception de ce qui s’était passé. Avec ce film, j’avais la volonté d’utiliser le cinéma à rebours de ce qui est souvent fait sur le sujet, mais aussi un peu à contre-courant des tendances actuelles d’un cinéma de plus en plus mangé par l’esthétique télévisuelle. Le cadreur, qui est aussi le chef opérateur, a travaillé caméra à l’épaule. On a choisi un iris avec une très faible profondeur de champ, qui l’obligeait à se tenir en permanence à soixante centimètres de l’acteur. Il fallait savoir le suivre et être très réactif.
Dans ce flou qui entoure le personnage, on distingue parfois des charniers, des exécutions… Le fait que ces images soient floues les rend presque plus insoutenables que si elles étaient exposées frontalement.
L’hypothèse de départ est simple : montrer frontalement l’horreur du camp contribue à réduire l’horreur, à la rendre compréhensible et regardable. Au contraire, ne percevoir que d’une manière fragmentaire ce qui est autour du personnage – par le flou, le hors-champ, les sons – fait naître dans l’imagination du spectateur une perspective de l’infini de l’horreur. En suggérant, on n’essaie pas de faire comprendre, mais de faire ressentir. C’est notre stratégie filmique, du début à la fin.
Le travail du son est admirable. Comment avez-vous abordé cet aspect ?
Quand je suis allé voir l’ingénieur du son et que je lui ai annoncé que le son représenterait 50 % du film, il a bien ri. Après cinq mois de post-production sonore, il ne rigolait plus tellement. Dans le film, alors que l’image est restreinte et restrictive, le son est là pour suggérer qu’il y a beaucoup plus, il offre un véritable contrepoint à l’image. Cet univers sonore est fait de chuchotements, d’ordres criés en plusieurs langues – parce qu’il y a plein de langues différentes dans le film –, et aussi du grondement continu du crématoire qui fonctionne sans cesse, qui est une bête vivante.
À Cannes, certains critiques ont reproché au film de reprendre l’esthétique d’un jeu vidéo. Qu’en pensez-vous ?
Et Béla Tarr, c’est du jeu vidéo aussi ? Ceux qui disent ça ne veulent pas réfléchir. D’ailleurs, contrairement à mon film, dans le jeu vidéo, en général, il y a une profondeur de champ énorme.
La comparaison fait davantage référence à l’aspect immersif du film.
C’est la vie qui est comme ça, on est dans une réalité tridimensionnelle. Cela dit, je peux comprendre qu’on n’ait pas envie d’entrer dans l’ici et maintenant des personnages.
Vous êtes un adepte du plan-séquence. Celui qui ouvre le film, notamment, est particulièrement marquant. Que permet ce format ?
Il permet d’avoir une immersion dans l’espace et le temps, dans l’instant du personnage ; c’est pour ça qu’on a voulu garder cette continuité. C’est intéressant aussi parce qu’avec le plan-séquence, l’équipe et les acteurs perçoivent la situation d’une manière extrêmement présente. C’est comme si on y était, et on le ressent quand on tourne : tout le monde se sent moins dans un film que dans une espèce de réalité.
Pourquoi avez-vous choisi de tourner en 35 mm, un format compliqué pour un film avec des plans séquences, de nombreux figurants ?
Le cinéma, c’est compliqué.
Oui, mais ça peut l’être un peu moins.
Je crois que les obstacles font partie du chemin, et pour moi la pellicule est indissociable de ce qu’est le cinéma. La pellicule est une matière vivante, et non immédiate ; il faut savoir la travailler, mériter l’image. Ça oblige tout le monde, y compris le réalisateur, à faire des choix avant et pendant le tournage, et pas après. D’ailleurs, sur un plateau où l’on tourne en pellicule, le degré de concentration est incomparable. Je trouve aussi extrêmement dommage qu’on soit en train de perdre la possibilité de présenter les films aux spectateurs en pellicule. La projection d’un film en pellicule, c’est l’image et l’obscurité alternées, c’est un processus hypnotique. Remplacer ça par de la télé sur grand écran, franchement, je ne comprends pas.
Qu’est-ce qu’on tourne après un tel film ?
Un thriller, l’histoire d’une jeune femme, en 1910, à Budapest. L’action se déroule à la fin d’une civilisation, en tout cas au début de la destruction de cette civilisation. On en est au stade du développement. En sous-texte de votre question, j’ai bien compris qu’il y avait l’idée de la pression qu’on peut avoir après un film comme ça…
Oui, et après un Grand prix à Cannes.
He bien, au pire, je raterai mon prochain film ! En tout cas, il sera très différent, et ambitieux d’une autre manière.
Le Fils de Saul
de László Nemes (1h47)
avec Géza Röhrig, Levente Molnár…
sortie le 4 novembre

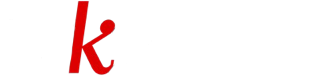 Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2
Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2