Vous avez obtenu l’Ours d’or à la dernière Berlinale. Que représente ce prix pour vous ?
C’était assez impressionnant de venir présenter un film dans un contexte politique aussi tendu. Je craignais que ça écrase la dimension artistique du projet et que ça se réduise à un angle polémique. Finalement, lors des échanges pendant la conférence de presse, je me suis rendu compte que parler du film suffisait pour que beaucoup d’enjeux politiques qui nous traversent aujourd’hui ressortent. J’ai senti que le film répondait à un besoin, et que les spectateurs étaient reconnaissants d’être amenés à réfléchir à ces questions. Ce prix a souligné cet alignement politique, que je ressens depuis que j’ai choisi de faire ce film.
Vous avez commencé à tourner en 2021, au moment du rapatriement des œuvres. Comment s’est concrétisée l’idée du film ?
L’idée d’un film, d’une fiction d’anticipation sur le parcours d’une œuvre, entre le moment de sa spoliation en Afrique et son rapatriement, que j’imaginais dans le futur, se tramait dans mon esprit depuis 2017. À l’époque, je me disais que la question des restitutions allait continuer de subir une profonde inertie. Je me voyais vieille dame, devant ma télé, en train d’assister aux premières restitutions ! Mais le réel m’a rattrapée, et ce film d’anticipation est devenu un documentaire fantastique.
Qu’est-ce qui rendait cette histoire si proche de vous ?
En tant qu’afrodescendante, elle me parlait intimement. Je ne pouvais que m’identifier au processus de retour de ces œuvres vers leur pays natal. Depuis 2008, à travers les films que j’ai choisi de réaliser à Dakar – le court métrage Atlantiques [en 2009, ndlr] puis Mille Soleils en 2013 et le long Atlantique en 2019 –, j’opère un processus de retour vers mes origines africaines qui s’apparente à un processus de « désoccidentalisation » [cette année, elle a lancé avec Fabacary Assymby Coly la société de production Fanta Sy, qui vise à accompagner de jeunes talents du continent africain, ndlr].
Quelque part, j’associe la question de la restitution des œuvres à celle de se restituer à soi-même. Quand, en 2021, j’ai découvert dans la presse que les trésors royaux du Dahomey étaient sur le point d’être rapatriés au Bénin [il s’agit de la première importante restitution d’objets de collections publiques à un pays africain, ndlr], le film a pris une dimension plus urgente. Il restait deux semaines pour organiser un tournage avant le jour du départ des œuvres du musée du quai Branly. Je n’avais qu’une certitude : il fallait filmer, archiver ce moment historique. En tant que cinéaste, j’ai pensé que c’était précisément mon rôle.
Les scènes filmées au quai Branly ont quelque chose de clinique. En même temps, vous filmez les pièces au plus près, on sent leur matière, leurs fissures. Comment avez-vous réfléchi au dispositif filmique ?
L’axe de gravité, c’était de donner un point de vue aux œuvres, qu’elles soient actrices et narratrices de leur épopée. Ce parti pris a structuré la manière d’approcher ces séquences au quai Branly puis tout le parcours à suivre. Joséphine Drouin-Viallard, la chef-opératrice, et moi sommes rentrées dans cette séquence avec deux caméras. Je filmais avec une toute petite, de très près, comme pour incarner l’intériorité des œuvres, tandis que Joséphine suivait une chorégraphie plus globale, qui incluait aussi le soin des conservateurs, les gestes des techniciens, les déplacements. Tout un cérémonial.

Ce point de vue des œuvres s’incarne dans une voix off profonde et spectrale, celle de la statue anthropomorphe du roi Ghézo. D’où vient ce choix narratif ?
Cette voix parle au nom de toutes les œuvres : d’abord celles qui sont condamnées au noir des sous-sols du musée depuis plus d’un siècle, puis les vingt-six élues sur le point d’être rapatriées. Mais cette voix renferme aussi toute une communauté noire, de femmes et d’hommes déportés pendant l’esclavage puis colonisés [au cours du xviie siècle, le royaume de Dahomey, futur Bénin, avait noué des liens avec la France dans le cadre de la traite des esclaves. Le pays a ensuite subi la colonisation française en 1894 avant de proclamer son indépendance en 1960, ndlr]. Elle renferme l’âme d’exilés. Pour certains, elle évoque celle de nos parents issus de l’immigration, qui ont été ou qui seront à leur tour ramenés au pays un jour.
D’ailleurs, je me suis beaucoup inspirée de L’Énigme du retour de Dany Laferrière, qui relate son retour en Haïti à la suite de la mort de son père à New York. Pendant le montage, j’ai d’abord fait parler les œuvres à travers des fragments de L’Énigme… C’était puissant de faire parler toute cette communauté d’âmes à la première personne, à travers l’expérience d’un homme exilé qui rentre au pays.
L’idée de la voix des trésors est arrivée assez vite dans le processus d’écriture. Je tenais absolument à ce qu’elle soit écrite par un écrivain ou une écrivaine haïtienne, Haïti étant peuplé de descendants d’esclaves qui ont notamment été déportés du golfe du Bénin. Le royaume de Dahomey était le berceau de la spiritualité vaudun qui a traversé l’Atlantique jusqu’à Haïti. À la fin du montage, j’ai voulu qu’un texte soit spécialement écrit. Mon ami Henry Roy, photographe franco-haïtien, m’a dirigée vers le travail du poète et écrivain Makenzy Orcel que j’ai rencontré et à qui j’ai confié l’écriture de la voix des trésors.
« On avait l’impression d’assister à un rite funéraire »
Le film est à la fois collé au réel et spirituel. Comment avez-vous joué sur la frontière entre documentaire et fiction ?
Je suis restée à l’écoute de ce qui, dans le réel, faisait cinéma. Calixte Biah, le conservateur qui avait été missionné depuis le quai Branly pour accompagner le retour des œuvres jusqu’au Bénin, s’est imposé comme un personnage central du film dès qu’on l’a vu. Il a tout de suite incarné quelque chose de romanesque. Je le voyais comme une sorte de gardien, garant des œuvres, qui les accompagnait d’un monde à l’autre. J’avais le sentiment qu’il partageait un langage secret avec elles. Je m’identifiais à lui parce que je sentais l’ampleur de la responsabilité qui lui avait été confiée de ramener ces trésors au pays. Moi aussi, je me sentais en mission ! J’étais très réceptive à toutes les émotions qui traversaient le musée. On avait l’impression d’assister à un rite funéraire.
Il y avait aussi un aspect chaotique qui m’a immédiatement évoqué « l’ère d’intranquillité des musées » dont a pu parler Felwine Sarr [économiste, universitaire et musicien sénégalais qui a cosigné en 2018 avec Bénédicte Savoy un rapport commandé par le gouvernement français sur la restitution du patrimoine africain, ndlr]. Dès que je suis arrivée au quai Branly, c’est ce que j’ai ressenti. J’ai eu la sensation de vivre un moment historique, de faire l’expérience d’une matière dense, multiséculaire, que j’ai voulu rendre palpable.
« Des milliers d’œuvres africaines sont enfermées dans des sous-sols de musées européens, réduites à l’oubli, au néant. »
Ce qui passe par tout un travail autour du son : celui des chaînes qui protègent les œuvres, celui des caisses dans lesquelles on les entrepose, qui renvoient aussi à une mythologie de l’exil…
A travers ce rapatriement, je voulais que le film rende sensible la mémoire et donc la trace du premier voyage de déportation de ces œuvres, des côtes béninoises atlantiques jusqu’en Europe, de même qu’il fasse écho à la déportation d’Africains vers les Amériques. Je voulais que cette mémoire traverse chaque plan, comme un spectre. Des milliers d’œuvres africaines sont enfermées dans des sous-sols de musées européens, réduites à l’oubli, au néant. C’est un espace d’effacement, de négation de l’histoire.
Quand je travaille ce type de relation à la mémoire, je ne sais pas à quel point l’ensemble des spectateurs s’identifie. Je m’adresse avant tout aux afrodescendants qui savent précisément ce à quoi le propos « j’ai dans la bouche un arrière-goût d’océan » fait référence. D’où l’importance de confier ce texte à un écrivain haïtien qui a hérité de cette histoire. Mais il s’agit moins de comprendre ces références historiques que d’en proposer une expérience sensible. Accompagner le spectateur pour qu’il remonte lui-même le fil de cette mémoire, de notre histoire.

Dans une séquence centrale, de jeunes Béninois se réunissent pour défendre un point de vue, ou creuser leurs histoires, comme avec cet étudiant qui raconte avoir été plus influencé par Tom et Jerry que par la culture béninoise…
C’est un débat que j’ai amorcé, qui n’aurait pas eu lieu sans cela, car il existe au Bénin un climat de censure où la parole libre n’est pas du tout encouragée. Je ne dis pas ça pour héroïser ma démarche, mais pour expliquer le contexte. Je rêvais d’une longue séquence de débat entre jeunes étudiants dans le film. Sans cela, il ne serait resté de ce rapatriement historique que des images d’actualité médiatique ou qu’un récit progouvernemental, officiel, national. Pour moi, c’était impensable. J’ai voulu me réapproprier ce récit pour mieux nous le restituer.
Je suis d’accord avec certains protagonistes du débat sur le fait qu’il y ait des chantiers plus urgents à traiter pour le continent africain. Mais on ne devrait pas minimiser l’importance de cette restitution pour autant. C’est un combat politique absolument majeur du point de vue de l’identité culturelle de l’Afrique, qui reste à reconstruire.
Pour ce débat, j’ai fait un casting pendant un mois. J’ai été assistée de Gildas Adannou, un jeune cinéaste béninois. Il fallait trouver des jeunes qui pouvaient assumer une parole libre et qui défendaient chacun un point de vue différent sur la restitution. Parler de restitution, c’est parler des stigmates du colonialisme, de mémoire, mais aussi d’amnésie. J’ai voulu sonder l’imaginaire de ces jeunes aujourd’hui.
«J’ai voulu rendre palpable une violence de classe que j’ai sentie très forte au Bénin»
Comme dans Atlantique, vous filmez des ouvriers, qui font un métier manuel ancien, précaire, parfois dangereux, et participent à la modernisation de leur pays. Qu’est-ce qu’on peut lire à travers ces images saisissantes ?
Le film Atlantique s’ouvre sur un immense chantier où de jeunes ouvriers exploités réclament leur salaire qu’ils attendent depuis des mois. On ne les reverra plus parce que, le soir même, ils émigrent vers l’Espagne en pirogue. À la suite de leur naufrage, ils reviendront hanter leur quartier sous forme d’esprits pour réclamer leur dû. J’ai voulu montrer la politique de ces villes nouvelles, comme celle de Diamniadio au Sénégal [une ville conçue en 2015, dont la construction a été financée par des promoteurs privés, ndlr], qui est censée désengorger Dakar, ultrasaturée. Les maquettes de chantiers de la ville étaient calquées sur le modèle des villes ultracapitalistes comme Dubaï. Filmer ces ouvriers exploités, c’est les rendre visibles, c’est être avec eux.
Dans Dahomey, je filme les ouvriers qui réfectionnent le palais présidentiel avant l’exposition, mais aussi toute la main-d’œuvre qui porte les caisses à bras-le-corps. Tout comme les ouvriers d’Atlantique, ils contribuent à un projet qui n’est pas fait pour eux, dont ils sont d’emblée exclus. J’ai voulu rendre palpable cette violence de classe que j’ai sentie très forte au Bénin. Une violence qu’on tente de dissimuler au prétexte d’un moment d’union nationale, mais qui est d’autant plus perceptible à mes yeux.
Entretien avec Mati Diop pour la sortie d’Atlantique
L’historienne de l’art Bénédicte Savoy me disait, lors de notre entretien, que, avec ses collègues, elle débattait sur la terminologie à adopter, notamment pour parler de ces pièces déplacées. Quel regard portez-vous sur ces discussions ?
Bénédicte produit un travail fondamental, avec une grande sincérité et une grande sensibilité. Je pense que c’est en effet notre rôle. C’est aux artistes, aux chercheurs, aux enseignants, aux activistes de prendre en charge cette question de « restitution ». C’est un terme qui a un sens profond. Avec Dahomey, je tenais avant tout à ce que le sujet soit restitué à la jeunesse africaine. J’espère que le film participe à cette réappropriation et contribuera à une revitalisation du débat depuis l’Afrique.
Dahomey de Mati Diop, Les Films du Losange (1 h 08), sortie le 11 septembre
Portrait de couverture : Manon Lutanie
Images de films : Dahomey de Mati Diop

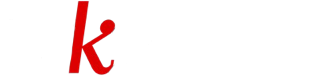 Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2
Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2