En bord de mer cannois, deux jeunes traînent sur leur Vespa. Un be-bop de Dizzy Gillespie et de longs travellings accompagnent l’errance de ces baratineurs fauchés. Leur but ? Vivre à tout prix une aventure charnelle sans lendemain. Irrépressible pulsion des corps sous le soleil méditerranéen, tournage léger en extérieur, vivacité de la caméra… Blue Jeans (1958), le troisième court métrage autoproduit de Jacques Rozier, alors âgé de 32 ans, est une danse à contretemps, langoureuse et urgente. En le voyant, on comprend le coup de foudre de Jean-Luc Godard pour ce film indolent, qui n’obéit à aucune exigence romanesque, si ce n’est celle d’un pur hédonisme. « Blue Jeans est frais, jeune et beau comme les corps de vingt ans dont parlait Rimbaud », écrit-il en février 1959 dans Les Cahiers du cinéma.
Jacques Rozier en 3 films libres et audacieux
La rencontre avec Godard scelle l’intronisation de Rozier dans le club des cinéastes défendus par la revue. François Truffaut, qui vient de réaliser Les Mistons, puis les critiques Jean-Louis Comolli et Hervé Le Roux, l’encensent. Malgré ces affinités immédiates, Rozier est trop atypique pour rejoindre la doxa de cette nouvelle génération d’auteurs. Jusqu’à la fin, Jacques Rozier fera passer cette liberté avant tout compromis. Comment le cinéaste qui incarna peut-être le mieux l’esprit revêche de la Nouvelle Vague en est-il aussi devenu l’outsider ?
Jacques Rozier fait ses armes à l’IDHEC, ancêtre de La Fémis, où il découvre le monde de la télévision. La furie du direct, la mobilité des appareils, le contact avec les figurants, Rozier, assistant de réalisation sur des émissions, est happé par cet univers frénétique. La télévision réveille en lui de vieilles amours, celles des cinéastes français de l’avant-guerre ( et ) et de leurs héritiers du Néoréalisme (Roberto Rossellini).
Lorsque Godard, après le succès d’A bout de souffle en 1960, convainc son producteur Georges de Beauregard de financer le premier film de Rozier, ce dernier est déterminé à disrupter les règles du jeu du cinéma traditionnel. Le tournage d’Adieu Philippine est un long chemin de croix : douze mois à flanc de montagnes corses, avec des amateurs choisis dans la rue, des dialogues volubiles à moitié improvisés pour conserver l’argot des comédiens, une bande-son prise en direct mais égarée en cours de route qu’il faudra reconstituer en postsynchronisation. Le montage s’éternise, la durée du film s’allonge, Rozier se fâche avec Beauregard, qui lâche le projet.
Après son rachat par Alain Raygot, il faudra attendre 1962 pour le découvrir à la Semaine de la critique cannoise, où il est présenté par Georges Sadoul et acclamé par Truffaut. Il n’en faudra pas plus pour que Rozier décroche sa réputation d’enfant terrible de la Nouvelle Vague. Ce chaos hors cadre et ces improvisations financières influencent le récit lui-même. Chez Rozier, tout est bifurcation. Comme s’il voulait se faire peur, éprouver les limites de son propre dispositif.
Adieu Philippine © mk2 films
ÉLOGE DU RISQUE
Une scène du film Du côté d’Orouët illustre cet amour du risque. Dans ce film de vacances féroce, Rozier filme un trio de copines en vacances sur la côte vendéenne, flanqué d’un benêt guindé (génial Bernard Menez) amoureux de l’une d’elles. Jusqu’au jour où un séduisant touriste (Patrick Verde) les emmène faire du bateau… Cette séquence est un pur instantané de cinéma-vérité. Alors que les vagues s’acharnent sur l’embarcation de fortune, la caméra tremblante de Rozier enregistre l’écume de la mer s’écrasant sur les personnages, tandis que Kareen (Françoise Guégan) s’époumone de peur. Les cris de l’actrice, les secousses prolongées… Tout semble vrai dans cette séquence. Au point que l’on se demande si le réalisateur n’a pas volontairement frôlé le naufrage pour servir le réalisme de la scène. Lui qui se rêvait matelot changeait de cap en permanence.

Du côté d’Orouët © mk2 films
Chez Rozier, la digression est d’abord géographique. Dans Maine Océan (1986), une danseuse brésilienne (Rosa-Maria Gomes) croise à bord d’un trajet Paris-Angers deux contrôleurs de la SNCF (Bernard Menez et Luis Rego) alors qu’elle n’a pas validé son billet. Tandis qu’une autre passagère (Lydia Feld) traduit leurs échanges, le ton monte, vacille vers l’absurde, avant l’heure de la réconciliation : ce quatuor improbable atterrira finalement sur l’île d’Yeu pour une virée maritime. Écrit en trois jours, tourné en trois semaines, Maine Océan traque, par un principe d’épuisement, des moments de vérité qui échapperaient à ses acteurs. Le détour compte plus que l’arrivée, les rêves perdus deviennent matière à fiction. Une autre société, dans laquelle chacun se définirait hors des clous, est possible : voilà la leçon de Jacques Rozier, que des cinéastes comme Guillaume Brac et Alain Guiraudie retiendront pour leurs propres utopies sociales.

Maine Océan © mk2 films
LA MARGE PRIME
Ce regard politisé distingue Rozier de ses homologues de la Nouvelle Vague. Dans les années 1960, avec Adieu Philippine, il est le premier à s’emparer des blessures encore fraîches, et taboues, de la guerre d’Algérie. Jean-Claude Aimini y joue Michel, machino à la télé, incapable de choisir entre deux filles. L’ombre de la guerre d’Algérie, où Michel doit bientôt partir, gagne du terrain sur la romance. Rozier procède alors par allusions : Dédé, un ami revenu d’Algérie quasi mutique, la menace futile de quelques guêpes sur la plage, et le soleil qui dessèche les cœurs resteront les seuls stigmates de cette guerre invisible. Aux milieux intellectuels, Rozier préfère, comme Maurice Pialat, la classe moyenne.
Pendant que Truffaut façonne son alter ego torturé Antoine Doinel, Rozier part à la rencontre d’une France périphérique. Avec Adieu Philippine, il documente l’émergence de la télévision comme culture de masse, largement délaissée par les auteurs de la Nouvelle Vague, qui lui préfèrent la contre-culture. Il immortalise le star-system dans Paparazzi (1964), court métrage documentaire sur le harcèlement médiatique subi par Brigitte Bardot pendant le tournage du Mépris de Godard. Rozier y met en regard le spectacle obscène mais fascinant des paparazzi, et celui, cinéphile, du tournage du film. Habile (et démocratique) stratagème pour réduire l’écart entre art moderne et art populaire. La liberté bien gardée de Jacques Rozier tient à ce syncrétisme, ce refus de choisir entre la télé et le cinéma, l’ironie et la séduction, la réflexion et le divertissement.
Rétrospective Jacques Rozier, 4 films, Potemkine Films, sortie le 4 septembre
Portrait de couverture : © Lazslo Ruszka

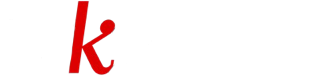 Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2
Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2